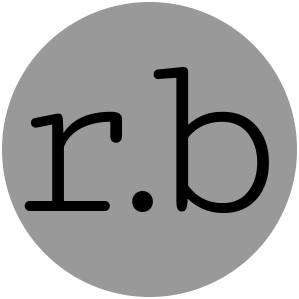I. Entrée dans le contemporain : l’exemption du sens du moderne
Parler d’usages contemporains de l’œuvre de Barthes revient d’abord à renvoyer dos à dos deux tentations dont les arguments reposent sur deux mythes contraires : la première se résume à un exercice d’admiration et consiste à dire que, tant que son écriture fascine, Barthes sera toujours notre contemporain ; la seconde prétend trouver dans certains pans de son œuvre les points d’un programme ou d’une méthode à poursuivre aujourd’hui : « le dernier Barthes[1] » notamment serait ainsi devenu, de nos jours, une boîte à outils mise à profit dans les dispositifs de « l’art contemporain[2] ».
Ces deux tentatives présentent pourtant le défaut de négliger ou de réduire la pensée très vivace et complexe du contemporain à deux objets construits à travers deux lentilles : un contemporain chronologique et un contemporain herméneutique. C’est ainsi qu’un concept de « contemporain[3] » comme réservoir de figures de sens obscurcies par tout ce que l’actualité donne à voir tente de prendre la place tenue autrefois par le moderne et tous ses dérivés[4]. Un autre contemporain s’y opposerait, qui serait synonyme d’actualité et dont les divers noms justifient diverses militances.
Sans doute la catégorie du contemporain ne se serait-elle pas imposée dans les débats théoriques depuis une vingtaine d’années s’il n’y avait eu un certain malaise dans la conceptualisation du moderne, sur fond d’eschatologies sécularisées dont les discours théoriques regorgent depuis un bon moment[5]. Dans une tentative téméraire de montrer que l’institutionnalisation de la modernité procède de la réforme grégorienne, au XIIIe siècle, et que l’idée de son « dépassement » postmoderne est en soi contradictoire[6], Bruno Péquignot rappelle et discute quelques-uns des arguments centraux formulés pour et contre une supposée fin de la modernité ouvrant sur le contemporain. Les contradictions que ces « fins » de la modernité font ressortir sont nombreuses, mais il en est une sur laquelle nous allons prendre appui puisqu’elle nous semble centrale dans la tentative de Barthes d’échapper au moderne. Il s’agit de la convergence entre direction et intelligibilité de l’histoire, postulée par Henri Meschonnic en 1988[7]. Il y remarquait la naturalisation d’une solidarité sémantique entre le mot « sens » compris comme direction, et le même vocable entendu comme intelligibilité : « La position typiquement post-moderne consiste à chasser ensemble les deux acceptions du sens[8]. » Péquignot ne donne pas de suite à cette idée, car ce qui lui importe, c’est de démontrer que la modernité ne s’est pas arrêtée avec la baisse de crédit imparti au progrès et la prétendue crise des promesses révolutionnaires des Lumières. Si c’est en 1977 que Barthes écrit : « tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne[9] », ce n’est pas que la modernité soit achevée, mais qu’être moderne n’est plus une exigence contemporaine. Autrement dit, le désintérêt de Barthes pour le moderne n’est pas l’effet du constat de la fin de la modernité, mais le signe d’un désinvestissement que le moderne subit au profit de mises à distance qui commencent à proliférer : le post-moderne est l’une des formes de ce tournant réflexif dont une autre est sans doute la prise de conscience du contemporain soit selon Agamben soit, depuis une toute autre position, selon Lionel Ruffel[10].
Or, il nous semble que la dissociation des deux significations du mot « sens », sens en tant que direction et sens en tant qu’intelligibilité, est essentielle pour caractériser le contemporain, à partir du présupposé que le contemporain émerge dans les débats intellectuels dès lors qu’on se dote de moyens pour dire l’intelligible en dehors de l’alternative entre progression et régression. Cette émancipation de l’intelligible ne vient pas arrêter l’histoire, ne serait-ce que grâce à la possibilité de la requalifier sous diverses formes, parmi lesquelles on pourrait mentionner la géohistoire en tant que « climat de l’histoire[11] » et l’histoire absolue en tant qu’« ancestralité[12] ». Ces formes appartiennent à ce que nous appelons le contemporain écologique, soit une pensée qui informe les « sciences humaines » au moment où « humain » ne saurait plus être détaché de son environnement.
Aucun texte de Barthes ne l’anticipe. Avant tout, le contemporain est, pour Barthes, une crise du moderne, une crise qui n’ouvre pas pourtant, et en dépit de ce que l’on pouvait croire à la charnière des années 1990, à une perspective debole[13], postmoderne. C’est précisément au creux de cette crise du moderne (qu’on peut situer, en France, aux alentours de 1968), que Roland Barthes lance cette idée d’exemption du sens, idée elle-même historique, autrement dit dotée d’une historicité et qu’il convient donc de ne pas lire dans l’absolu. L’exemption du sens marque l’entrée dans une théorie du contemporain qui s’inspire de Nietzsche et dont le dernier Barthes est, selon Giorgio Agamben, exemplaire[14].
Ce sont peut-être les impasses de différents concepts directionnels de l’histoire (conquête de la nature ; progressisme communiste ; conquête de l’espace vital nazi, etc.) qui ont levé le voile sur le biologique en tant qu’instance fondamentale dans la production du – et l’attachement au – sens. Si la « vie nue » est l’un des enjeux essentiels de la philosophie de Giorgio Agamben[15], c’est précisément parce que, afin de pouvoir s’imposer dans la pensée, il aura fallu que ses revêtements, celui métaphysique en premier lieu – « existence », « Dasein » – en soient venus à une usure laissant voir une trame jusqu’alors inaperçue.
***
C’est ainsi que, dans son « Avant-propos » à la nouvelle édition du cours de Barthes sur le Neutre, Éric Marty trouve qu’il est essentiel d’expliquer pourquoi le neutre reste, chez Barthes, une valeur vitale et pourquoi, par conséquent, il y a moyen d’éviter la confusion entre « vouloir-vivre » et « vouloir-saisir », et l’assimilation du neutre à l’absence du désir, à la suppression du pathos[16].
Un premier commentaire excellent de « l’exemption du sens » apparaît en 2013, sous la plume de Samuel Estier, sur le site du mouvement Transitions[17]. Quoique l’auteur se trompe légèrement[18] quand il écrit que « c’est dans L’Empire des signes qu’apparaît pour la première fois l’expression “l’exemption du sens”, intitulé d’un des quatre petits chapitres consacrés au haïku[19] », il a raison de faire le lien direct entre la découverte du Japon en 1966 et le trait « exemption du sens[20] » qui la caractérise, par apophase. C’est aussi le moment de la « mort de l’auteur », actée en 1967 lors de la parution de la traduction anglaise de Richard Howard dans Aspen[21]. Arrimés à ce triangle référentiel – mort de l’auteur, Japon, exemption du sens – nous pouvons maintenant donner une lecture affective d’un passage clé de cet article, dans sa version française originale, portant sur la libération du signifiant de la tutelle du signifié.
(…) la littérature (il vaudrait mieux dire désormais l’écriture), en refusant d’assigner au texte (et au monde comme texte) un « secret », c’est-à-dire un sens ultime, libère une activité que l’on pourrait appeler contre-théologique, proprement révolutionnaire, car refuser d’arrêter le sens, c’est finalement refuser Dieu et ses hypostases, la raison, la science, la loi.[22]
Il ne faut surtout pas voir cette libération comme le geste violent d’une destruction. Se libérer de l’impératif téléologique dans la lecture, ce n’est pas briser des chaînes, tuer des maîtres intransigeants. Il s’agit d’abord de la traduction d’une expérience sensible – l’écriture. L’écriture, c’est le Japon qui l’ouvre comme « situation », et c’est là que surgit l’exemption du sens, syntagme que Barthes mentionne dès la première page de l’Empire des signes : il se laisse immerger « dans » le Japon (qui « l’étoile d’éclairs multiples[23] »), et cette immersion « opère un vide de parole […] qui constitue l’écriture […] dans l’exemption de tout sens » et qui, sous cette magie, « écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets, les visages, la violence[24] ».
Sachant combien cette figure lui tient à cœur, nous sommes autorisé à dire que l’exemption du sens découle au premier chef d’un relâchement, d’une déprise qui n’est autre que l’abandon d’une voie donnée à suivre, de la grégarité du mainstream, enfin de ce qui, en cette fin des années 1960, s’annonce de plus en plus comme la seule voie possible à mener, celle de l’accumulation[25] et de l’accélération[26], d’un totalitarisme dont la dénonciation revient à dénoncer la – ou du moins une certaine – modernité.
Le relâchement du sens, que Barthes éprouve au Japon, est loin du non-sens. Estier le montre bien : l’exemption du sens, c’est en premier lieu la libération de la pensée symbolique[27] – et c’est encore à ce niveau de politique figurale que la littérature créatrice d’exemption du sens est « contre-théologique ». Mais le non-sens guette à chaque moment cette déprise, puisque la première impulsion de celle ou celui qui fait un pas de côté, hors des cadres dans lesquels il ou elle vit – et qui sont les mêmes cadres qui composent ce qu’on appelle la modernité – est de s’y opposer. Le personnage de l’Étranger de Camus, Meursault, en dépit de son impassibilité, monte sur une scène morale qui n’est qu’un contre-lieu par rapport à celui que régit la bourgeoisie bien-pensante[28]. Et c’est la même attitude, d’opposition, qu’affirme Barthes dans son plaidoyer contre l’auteur. Mais rien n’est définitif. L’exemption du sens revient à son contexte d’origine, japonais, puis bouddhiste (le Zen), chinois (le Tao), pour rejoindre le degré zéro : « Neutre = force qui s’applique à déjouer le paradigme (premier cours) → deux postulations : 1) exemption, annulation → « degré zéro » 2) tourniquet perturbé et perturbant, irrégularité → en somme : Neutre = annuler et/ou brouiller[29]. » Le contexte de l’exemption du sens a pour synonyme « déjouer le paradigme[30] ». Ainsi, le Japon, le Zen, le taoïsme ne sont pas des contre-éthos occidentaux, pas plus qu’ils ne désignent le néant existentiel : ce sont ces cadres qui ne s’agencent plus pour brosser une direction, mais qui laissent voir des formes de vie : visages, gestes, lieux, une vie que n’absorbe plus la force messianique engendrée par « le soleil qui se lève au ciel de l’Histoire[31] ». D’où la liberté que Barthes traduit en liberté d’écrire et qui peut être à son tour lue de deux manières : soit, comme l’ont fait les postmodernes, par une esthétisation outrée du réel – jusqu’à la déréalisation, et alors la littérature devient plutôt une dérive ; soit par une reconfiguration inouïe du réel qui n’est qu’une réinvention – et c’est à peine maintenant que l’exemption du sens est, à proprement parler, dans son sens cosmologique, révolutionnaire.
Il s’agit, certes, d’une révolution moléculaire, d’une tout autre granulation que les révolutions modernes qui l’auraient précédée. Et c’est cette révolution que nous croyons pouvoir appeler contemporaine. La raison cardinale qui permet une forme indéniablement paradoxale d’assertivité du neutre, c’est la permanence, mais sous d’autres formes, du pathos, car « “déjouer le paradigme”, est une activité ardente, brûlante[32] » : il y a un « pathos du neutre[33] », mais la possibilité de le communiquer est limitée par les connotations des deux vocables ainsi reliés. L’opposition sens / exemption du sens, politique au début, dans les années 1940, devient maintenant ontologique. Le pathos est ainsi transféré, du combat vers à l’état du neutre – ou bien, Barthes le propose mais le retire aussitôt, car « cela ne prendrai pas » – de « l’idéologie » à la « pathologie[34] ». Si la révolution idéologique relève de l’occidentalisme, car elle engage avant tout l’intelligibilité en tant que direction et essence universellement humaine, l’exemption du sens se manifeste à travers des petites patho-logies qui, tout en venant à organiser le quotidien dans ce qu’il a de plus ténu, au niveau individuel ou tout au plus de groupe (mais jamais à l’échelle des masses, sociétale), crée un rythme qui nourrit la « grammaire de la vie[35] », un rythme que les sociétés modernes, uniformisantes, tendraient à évacuer[36].
***
Si l’exemption du sens, chez Barthes, vise d’abord le langage verbal, il ne s’y arrête pas. En découvrant le haïku, le sémiologue français peut aller au-delà de la littérature, au sens occidental[37]. C’est un peu plus tard qu’il prend contact avec la création de John Cage[38], une œuvre musicale au cœur de laquelle on retrouve une forme d’exemption du sens, et qu’il constate la subversion de la temporalité saisonnière opérée par l’accélération des échanges dans le monde néolibéral.
Lorsqu’on nous dit que ce fut le bruit de la grenouille qui éveilla Bashô à la vérité du Zen, on peut entendre (bien que ce soit là une manière encore trop occidentale de parler) que Bashô découvrit dans ce bruit, non certes le motif d’une « illumination », d’une hyperesthésie symbolique, mais plutôt une fin du langage : il y a un moment où le langage cesse (moment obtenu à grand renfort d’exercices), et c’est cette coupure sans écho qui institue à la fois la vérité du Zen et la forme, brève et vide, du haïku[39].
Comme le constate Lionel Ruffel, le contemporain est plus qu’un « moment de la modernité[40] », car il ne s’y inscrit que pour s’y dérober, mû par un désir qui a du mal à se laisser définir[41]. Ce contemporain aura donc une valeur heuristique et d’orientation dans un monde moderne qu’il déborde. Car, bien qu’il réside dans cette même relation entre l’individu et le monde, il ne s’oppose pas à l’historicisme ; il ne s’arrête pas non plus aux confins de l’histoire sociale. Être contemporain c’est, désormais, prendre en compte le monde vivant, même à travers une remarque anodine, telle que la suivante :
Au marché Saint-Germain, j’ai trouvé des cerises (elles viennent d’Australie). On me dit qu’au marché de Buci, encore plus populaire, il y a aussi, maintenant, des fruits hors saison. Même si ces produits restent chers, très chers, c’est tout de même un peu Fauchon dans la rue. Mais ce n’est pas l’énigme économique qui me retient; c’est plutôt ceci: que le progrès technique (faire venir des fruits en quelques heures des antipodes) dépossède l’homme du temps juste des saisons (de leur tempo) et peu à peu – « croyant bien faire » – le frustre d’une jouissance, celle de l’alternance; car il y en avait peut-être une à attendre la fin de l’hiver, à voir poindre, disparaître, à regretter les belles choses, en tant qu’elles passent et reviennent: fini la plus grande des joies, celle du retour. Désormais, à l’horizon, des marchés sans primeurs : passé le temps des différences[42].
Après avoir trouvé des cerises en plein hiver, ce n’est pas la jouissance de la surprise offerte par superposition entre la cerise et la saison hivernale qui interpelle Barthes. Il y a évidemment une valeur économique et sociale dans cette présence des cerises là où elles ne poussent pas. Il s’agit surtout de l’écoute d’un tempo, du suivi d’un rythme. La suppression des temps d’attente constitue elle-même un service qui se vend et qui, en tant que tel, défie le rythme saisonnier du climat qu’on habite. Barthes, dans cette petite livraison pour le Nouvel observateur, « pense le temps comme un élément géographique » faisant écho à « l’incompressibilité […] des temps du vivant[43]. » Sans doute ne le fait-il pas pour souligner la « plasticité[44] » du temps. Il avertit plutôt que trouver des cerises en hiver, dans un pays tel que la France, c’est capitaliser sur la cassure du tempo naturel des saisons : le printemps peut être désormais, en partie du moins, vendu et acquis comme produit.
Cette « mythologie » de la nature devenue marchandise rend compte avant tout de la nostalgie d’un Barthes vieillissant pour les « bons vieux temps », renforcée par le sentiment d’exclusion que Barthes a devant une culture populaire fétichisant le corps jeune[45]. La présence des cerises en hiver connotent une aliénation non de la « nature » en soi, mais d’un rythme qui associe le quotidien humain à celui non-humain. Le rythme saisonnier est atténué et finalement englouti par le présentisme du marché global cherchant à attiser le désir de jouir d’une masse de consommateurs[46]. Barthes semble parfois exploiter des notions qui, lues aujourd’hui, disent son assentiment à l’individualisme galopant de l’époque, telle la jouissance. Mais la source de cette jouissance, qui n’est jamais associée à ce qu’on comprend communément quand on dit « jouir », c’est un accident de tempo.
Si l’on suit attentivement le cheminement du mot dans Le Plaisir du texte, par exemple, on se rend bientôt compte qu’il s’agit de différentes versions de l’exemption du sens : le texte-Babel, où « le sujet accède à la jouissance par la cohabitation des langages, qui travaillent côte à côte[47] ». La jouissance est imprévisible : « imprévision de la jouissance : que les jeux ne soient pas faits, qu’il y ait un jeu.[48] » nfin, pour Barthes, on ne comprend pas la jouissance sans le plaisir. Autant le plaisir se sécrète dans le continuum de la culture, dans le confort, autant la jouissance s’exprime par une suspension instantanée qui se produit lors d’une lecture, qui n’a pas de degré car elle est irréductible car incomparable, unique en tant que vécu, non comme objet. Car la jouissance repose sur un effritement, un « vacillement » dans l’homogénéité supposée du moi[49]. Et c’est ainsi qu’on revient au haïku. C’est, semble-t-il, sa lecture qui repose le lecteur qui a avec le langage « à la fois de désir de jouissance et de douleur », car « je sens et j’entends dans ce haïku une sorte de raréfaction presque enivrante, tellement elle euphorise et elle pacifie.[50] » « Le haïku est au fond proche d’un petit satori, d’une petite secousse mentale » qui colle au lecteur « anachronique », celui qui jouit de la « consistance de son moi[51] » tout en recherchant sa perte, sa dissolution.
Or, le haïku est une forme qui se manifeste d’abord comme rythme. Quand Barthes dit que « tout rythme est civilisé » il condense dans cette assertion l’appartenance commune du rythme à la culture et à la nature. À la culture, d’une part, en tant que lieu de la langue ; et à la nature, aussi, en tant que pulsion, corps. « Tout rythme, dit Barthes, a pour fonction d’exciter ou d’apaiser le corps », mais ces deux effets sont équivalents en tant que moyens d’« intégrer le corps à la nature (…), le réconcilier, le dé-sevrer.[52] »
Barthes arrive ainsi à esquisser un écosystème sémiologique dans lequel le rythme est comme un plan d’immanence. Il est saisi au cœur de son ambivalence : d’abord un retard (« Casals disait très bien que le rythme c’est le retard[53] », car la pulsion individuelle doit attendre que s’achève un intervalle sans lequel la jouissance même s’efface à terme), mais aussi une liberté, car ce qui l’atteste, c’est ce qui vient après chaque retard : « la succession de l’Ascèse et de la Fête ».
Le rythme est à la fois une certaine manière de s’éprouver libre, de se joindre au monde et à la multiplicité des formes de vie. Barthes le dit ou le suggère à plusieurs reprises dans ses notes préparatoires aux cours sur la musique, prises à Bucarest en 1948. Il souligne par exemple l’importance du rythme dans la musique noire qui, à l’époque, était en train de s’imposer en Europe: « Le jazz : tentative de créer du bruit avec des sons pour donner une impression de sur-rythme. N’accepte le son que dans la mesure où il est nécessaire au rythme […] ; règne du rythme ». Plus tard, il écrit à propos d’Yves Montand : « Chante avec tout son corps. Rythme corporel, il libère la biologie du public. Sa voix est un peu vulgaire, mais elle a en plus : l’espoir. Une voix où il y a un espoir organique, profond, irrésistible, calme et irrépressible[54]. »
Lu depuis un point de vue écologique, le relatif « anti-modernisme » du dernier Barthes doit être revu et corrigé[55]. Car Barthes aura été critique d’un certain « modernisme » synonyme de progressisme et de grégarisme, mais qui est loin d’incarner à lui seul la modernité ; et ses attitudes « antimodernes » sont davantage liées à la conscience de son propre vieillissement et au chagrin consécutif à la mort de sa mère qu’à quelque embrigadement partisan. Si l’écriture barthésienne a traversé toutes les affres de l’apophatisme, de la pensée critique se retournant contre elle-même (aveux de dilettantisme et d’ignorance), du roman qui s’annonce et ne réalise jamais, du journal qui s’écrit et se suspend, tout ce sur quoi elle s’appesantit n’est pas « contemporain », au sens de « l’art contemporain », comme le rappelle bien Pascal Mougin qui ne cesse de ramener la critique d’art barthésienne au « modernisme » et à la relation expressive entre l’auteur et l’œuvre[56]. Car il ne s’agit pas de faire de Barthes un héraut du présent. Si Barthes nous est contemporain, c’est aussi parce ses textes engendrent des formes dont le contour et le parcours font signe vers le réel en tant que possible. Marielle Macé remarque bien que « chez Barthes, la lecture n’engage pas tellement l’œuvre comme milieu habitable […] ; non, dans une conception mobile, exploratoire et instable de la subjectivation, c’est chaque phrase qui se présente comme une invitation gestuelle, la requête ou la promesse d’activation d’une conduite[57]. » Si Barthes ne tient plus, à partir d’un certain moment, à être moderne, c’est que sa conception de la subjectivation aura été marquée par l’expérience et la pensée du rythme.
II. Le rythme comme opérateur du contemporain écologique
L’importance du rythme, chez Barthes, s’accroit au fur et à mesure que Barthes s’intéresse à d’autres formes d’art que littéraires : tout d’abord, la musique. Barthes convoque le rythme à travers le corps en tant qu’outil artistique : la main qui écrit et la voix qui chante manifestent leur appartenance au corps qui habite. Plus tard, il se met aussi à l’écoute de la vie quotidienne, marqué par certaines expériences liées à l’art contemporain (pop-art, musique de John Cage[58]). Barthes contribue à sa manière à un travail largement anthropologique, attentif à rediriger l’attention vers les « arts de faire » négligés par les discours intellectuels dominants[59]. Ce faisant, il pointe vers le contemporain écologique. Sensible à l’ouverture écologique de la musique et de la théorie musicale de Cage, Barthes n’était pas du tout intéressé par ce que Bruno Latour allait appeler les « politiques de la nature[60] » : « Dernier trait qui rattache le pop art aux expériences de la Modernité : la conformité plate de la représentation à la chose représentée » écrit-il dans un article paru en 1980, propos qu’il illustre avec un mot de John Cage : « L’objet est fait, non symbole[61]. » L’objet en question, c’est le son. Barthes semble impressionné ici par l’expression d’une pensée pragmatiste mais aussi écologique, car une telle phrase reconfigure l’objet au sein d’une enquête anthropologique au-delà de la séparation entre culture et nature.
L’importance du rythme, pour Barthes, est liée en premier lieu à sa pratique musicale. « Barthes approche au plus près la rationalité affective et psychique de la vie avec et par la musique », constate François Noudelmann[62] qui, dans un texte antérieur reliant rythme et contemporain chez Barthes, ne s’est pas attaqué à ce sujet.[63] Ce qui est remarquable chez Barthes, c’est qu’il ne se contente pas de constater le rôle du corps dans tout exercice, écriture comprise − (« bien écrire (…) c’est mettre un mot “en valeur”, en croyant obtenir par là un rythme “expressif”[64] ») −, mais revient toujours à l’importance, dans l’observation du rythme, aux formes amateures des pratiques. Le praticien amateur est le seul à pouvoir éviter la répétition à l’identique, et c’est déjà une forme d’idiorythmie qu’il crée, soit par l’ignorance en tant qu’espace de liberté innocente, car il s’agit d’un espace ménagé dans les marges des ordres à reproduire, soit par un défi délicat, synonyme d’une attitude connue à la Renaissance et notamment chez Montaigne sous le nom italien de sprezzatura, en français « négligence[65] ». La pratique d’amateur[66] est appréciée par Barthes dans la mesure précise où, à la différence du professionnel, elle déclenche, à travers ce que l’amateur fait, une expérience toujours autre, qui exclut le ressassement.
L’amateur, rôle défini par un style bien plus que par une imperfection technique, ne se trouve plus nulle part ; les professionnels, purs spécialistes dont la formation est tout à fait ésotérique pour le public […], ne présentent jamais plus ce style de l’amateur parfait dont on pouvait encore reconnaître la haute valeur chez un Lipatti, chez un Panzéra, parce qu’il ébranlait en nous non la satisfaction, mais le désir, celui de faire cette musique-là. En somme, il y a eu d’abord l’acteur de musique, puis l’interprète (grande voix romantique), enfin le technicien, qui décharge l’auditeur de toute activité, même procurative, et abolit dans l’ordre musical la pensée même du faire[67].
Le rythme de l’interprète-amateur n’est jamais celui requis et c’est parce qu’il diverge de la norme qu’il réunit en une sorte de corps à corps le sujet et l’objet (musical) dans une expérience unique : « À travers des tempi trop lents, des fausses notes, j’accède quand même à la matérialité du texte musical, parce que cela passe dans mes doigts. Toute la sensualité de la musique n’est pas purement auditive, mais aussi musculaire[68]. »
Ce que réalise le rythme, c’est avant tout moduler l’enchevêtrement du social et du naturel, au sein d’une « écologie des relations » comme nous le montre par exemple l’exposition homonyme qui ouvre ses portes en janvier 2026, à Marseille[69]. Dans un texte sur le pop-art, Barthes avait déjà pris la mesure de ce « maillage[70] » du naturel et du social. Cet art, dit-il, puise dans « la Nature ; non plus certes la Nature végétale, paysagiste, ou humaine, psychologique : la Nature aujourd’hui, c’est le social absolu (…)[71] ». S’il y a une nature du social, il doit y avoir une socialité de la nature, ce dont il prend acte au moment de la « dé-définition de l’art[72] », notion à travers laquelle Harold Rosenberg dénonçait la « naturalisation » des conventions par les institutions modernes. Si c’est ce geste critique qui autorise le rapprochement de Barthes et de Rosenberg sous le label général et généreux de « postmoderne[73] », on peut en trouver un autre, cette fois plus radical : si les définitions de l’art sont construites, ce n’est pas parce qu’il n’y aurait pas d’art, mais plutôt parce qu’il y a de l’art là où on ne l’attend pas. C’est pourquoi on peut bien y voir une extension de l’exemption du sens qui, en l’occurrence, se donne à lire aussi comme empuissantement[74] réciproque entre naturel et social, entre besoin et désir – que réunit le vivant. Ainsi, la vie ne saurait plus se penser séparément, selon la distinction entre le commun du quotidien et l’irréductible de l’exception, entre immanence du geste naturel et métaphysique du projet artistique : « derrière nous, la biosphère tout entière avance, à son rythme d’une parfaite lenteur, pour expérimenter tous azimuts d’autres aventures de l’intelligence vivante (…)[75]. » Si le rythme devient important pour Barthes, notamment à partir de la pratique musicale, il ne subordonne pas pour autant le rythme à l’art de la musique. En même temps que la musique, c’est « le rythme monotone de la vie de Sana[76] » qui l’isole et qui aiguise sa réflexivité devant le rapport physique qu’il a avec le monde. Non pas que la musique qu’il entend lui plaise toujours, mais elle est, qu’il s’agisse de celui qui la pratique ou bien de celui qui l’écoute, révélatrice d’une certaine manière d’habiter : « Pour la pop-music, il y a un contenu corporel, auquel cette forme de contre-culture accorde une grande importance. Il y a là un rapport nouveau au corps qu’il faut défendre[77]. »
***
À travers ses matérialisations, le rythme rend indissociables la socialité de la nature et nature du social, sous l’égide du vivant. Tout son essai sur le Japon, L’Empire des signes, est parsemé de notations sur le corps : l’essai compte plus de soixante occurrences du mot « corps », et Barthes arrive à identifier un « corps japonais » différent du corps occidental en ce qu’il ne vit pas selon le principe de l’isolement, mais de l’intégration : « L’individualité n’est pas ici clôture, théâtre, surpassement, victoire ; elle est simplement différence, réfractée, sans privilège, de corps en corps[78]. » C’est le corps qui fait habiter le sujet, à travers le rythme.
Penser le rythme revient, cette fois, à intégrer tout ce qu’il traverse : tout un réseau d’objets, d’êtres, d’affects, d’ondes, sans s’arrêter aux confins de l’histoire littéraire ni des « sciences humaines ». Agir en amateur, pour Barthes, c’est en premier lieu agir en tant que « point de vie » selon le syntagme d’Emanuele Coccia[79]. « L’on ne pourra jamais connaître le monde en tant que tel, sans passer par la médiation d’un vivant », écrit le philosophe italien[80] qui veut dire ainsi que connaître depuis la perspective surplombante d’un sujet-maître n’a jamais été une option pour aboutir à quelque vérité que ce soit. C’est de cette manière que, pour Barthes, le rythme ne renvoie pas à une science des formes fixes[81]. Si le rythme est souvent synonyme d’ordre, l’ordre dont il s’agit y est immanent. C’est pourquoi le rythme n’est jamais prisonnier d’une pensée politique qui s’appuie sur le binôme liberté/nécessité, car une telle politique ignore la dialectique de dépendances et d’affranchissements que les rythmes déploient à travers leurs divers parcours.
C’est également à partir du rythme que Barthes conçoit une aisthésis, une « science » du sentir. Il rejoint ici la critique qu’Agamben fait à la pensée foucaldienne de la subjectivation, vers une aisthésis qui prend ses distances avec la pensée métaphysique moderne : les œuvres du contemporain sont des formes de vie au sein d’une « zone d’irresponsabilité, où les identités et les imputations du droit sont suspendues[82] », relevant toujours d’une subjectivation que, selon Agamben, Michel Foucault n’a pas voulu voir : « Ce que Foucault ne paraît pas voir […] c’est la possibilité d’une relation avec soi et celle d’une forme de vie qui ne prennent jamais l’aspect d’un sujet libre […] la possibilité […] d’un Ingouvernable qui se situe au-delà des états de domination et des relations de pouvoir[83]. » En ce sens, ce qu’Agamben désigne par cette puissance, c’est le régime d’un « vivre ensemble » échappant au pouvoir, qui se situe dans l’entre-deux entre œuvre – œuvre de vie, découlant de la vie – et vie « nue ».
C’est ainsi que Barthes s’empare de la notion d’idiorrythmie. En raffinant, à partir de l’étymologie récupérée par Benveniste, la signification du rythme en tant que ῥυθμός, rhuthmos. Il oppose ainsi la « polyrythmie[84] » du monde en tant que monde vivant, et le « rythme plat de la modernité : travail/loisir »[85] qui n’est qu’un ressassement stérile. Se penchant sur l’étymologie du mot telle qu’elle nous est rappelée par Benveniste, Barthes observe le caractère fluide du rythme qui « renvoie aux formes subtiles du genre de vie[86] ». C. Sandoz montre que ῥυθμός est en effet une « forme dynamique » qui peut prendre la signification soit de disposition (psychologique), soit de « écoulement » musical[87]. Si l’usage de l’idiorythmie, dans Comment vivre ensemble notamment, lui est inspiré par Jacques Lacarrière[88], il n’était pas le seul penseur français à s’intéresser à une théorie éthique et politique du rythme : le rythme est un concept majeur dans l’œuvre de Henri Lefebvre qui, bien avant son ouvrage posthume qui se consacre à la « rythmanalyse », en fait le pivot de l’opposition entre temporalité moderne et temporalité traditionnelle et la pierre angulaire d’une écologie des relations menacée dans le tome second de sa Critique de la vie quotidienne : « rythmes, cycles, régularités antiques, représentations ancestrales du cosmos et de l’action humaine, tombent en pièces de nos jours[89]. » Saisir le rythme, c’est apprendre et faire à la fois, une alternance que le sujet ne peut assurer autrement qu’en tant qu’il arrive à faire du rythme une manière d’habiter le monde.
Car ce qui se pratique s’acquiert, à force d’exercice. C’est ainsi qu’Yves Citton fait voir comment, à partir du rythme, Barthes construit sa propre écologie :
je ne puis être un musicien qu’en acceptant de suivre ces contraintes : c’est par cette composition collective que je peux, avec d’autres, faire le temps que je suis. On comprend que les enjeux de la musique pratique vont bien au-delà des questions de rythme, de retard et de ralentissement – ou plutôt, on comprend que les questions de rythme vont bien au-delà de la seule sphère musicale[90].
Il y a une manière d’écouter de la musique qui invite à en faire, tout comme il y a la lecture qui précède l’écriture[91]. Le « faire » est latent dans toute réception d’un objet de désir, et plus on reste sous son emprise, plus on a envie de le « (re)faire ».
Cet usage du rythme en tant que concept et pratique, par lequel l’individu habite le monde et s’en laisse habiter, porte deux conséquences. Une conception rythmique de l’écriture exclut le métadiscours, car il n’y a pas de conscience dont le langage pourrait s’emparer du rythme sans y être soumis à son tour. Tous les discours participent de la même forme rythmique, en dépit de la diversité des rythmes. On retrouve ainsi une écologie du discours qui rompt avec la perspective agonistique d’une compétition discursive où plus la remarque est générale et fondée dans la rhétorique de l’argument, plus elle est « vraie »[92].
D’autre part, la conception rythmique de l’existence constitue, à travers l’idiorythmie, un prisme heuristique par lequel on peut imaginer « Gaïa » : le monde de la vie conçu comme une entité composite mais auto-suffisante, à la subsistance duquel tous les vivants contribuent par le simple fait de leurs vies[93].
Or Gaïa est précisément cette « nature » qui nous inclut, sans qu’elle soit « un tout déjà composé » et active, « sans lui ajouter une âme[94]. » C’est une hypothèse peut-être osée, mais nous pouvons la risquer : par rapport au paradigme, Gaïa est la plus récente matérialisation du Neutre. Si elle est bien vivante, elle fuit toute métaphysique de la vie ; et si elle est aussi l’objet d’une science positive, elle est a-systémique[95], tout comme le Neutre : « Au fond, le Neutre, c’est ce qui n’est pas systématique, donc un retrait qui serait systématique ne serait pas du Neutre[96]. » Parler de Gaïa et du Neutre revient à pratiquer un art de la parole apte à saisir et dire ce qui, à l’intérieur de « l’apparemment même », apparaît comme différent[97]. Le rythme est un tel opérateur de différence pour des objets qui ont la même apparence : le neutre est différent du retrait, de l’abstention, de la passivité, tout comme Gaïa n’est ni tout à fait la Terre, la planète ou encore « tout[98] ». Le rythme fait voir, d’une part, la différence entre histoire et géohistoire, que l’Anthropocène en vient à court-circuiter[99], tout comme « l’homme Tao » déterritorialise le sujet, en l’« inorganisant » et en transformant le monde qui l’entoure « en une image presque incompréhensible et scandaleuse[100] ».
C’est dans cette perspective qu’il faudrait placer l’idiorrythmie : une uchronie[101], cet état instable (ou bien « métastable[102]) » dans lequel le rythme individuel peut ignorer la dynamique de la vie urbaine sans pour autant renoncer absolument au social. En fait, l’idiorrythmie, c’est la réconciliation entre le corps individuel et les enveloppes écologiques où il vit. La découverte de l’idiorrythmie, c’est la découverte, pour Barthes, d’un idéal d’habitation, mais un idéal relatif, en tant qu’il lui manque cette propriété essentielle qui est la stabilité. L’idiorythmie comme « rapport pratique aux autres en tant qu’ils vous laissent ou ne vous laissent pas “vivre seul” », il le rappelle dans La Préparation du roman[103], dans une phrase qui est elle-même bercée. Le rythme, c’est plus qu’un mouvement jugé acceptable en tant que vivre ensemble : c’est l’entérinement de l’indécision.
Cette idée de rythme, Barthes arrive à l’isoler de l’acception courante du mot. Dans Comment vivre ensemble, il baptise « idiorrythmiques », rappelons-le, « les formes subtiles du genre de vie : les humeurs, les configurations non stables, les passages dépressifs ou exaltés ; bref, le contraire même d’une cadence cassante, implacable de régularité[104] ». Pour insister sur cette distinction, Barthes ajoute : « C’est parce que le rythme a pris le sens répressif (voir le rythme de la vie d’un cénobite ou d’un phalanstérien, qui doit agir à un quart d’heure près) qu’il a fallu lui adjoindre idios[105]. » Il montre par là que l’idiorrythmie est « presque un pléonasme », car le rythme se livre toujours en tant qu’idiorrythmie. Barthes trouve dans cette notion une incarnation magistrale d’un modèle d’espace-temps qui pourrait être intégré à la série des versions données par les autrices de Terra Forma. Dans cet ouvrage rédigé par deux architectes-cartographes et par une historienne des sciences et metteuse en scène, les cartes et leurs descriptions tâchent de défamiliariser l’œil et l’esprit humains habitués à une orthodoxie représentationnelle héritée de la Renaissance, à travers un « manuel des cartographies potentielles ». Parmi les sept chapitres de l’ouvrage, le chapitre V, « Espace-Temps », tente de « combiner et superposer des tempos différents – ce que la musique contemporaine appelle polyrythmie[106]. » L’un des enjeux des trois autrices est de faire comprendre autrement, à travers « cartes vivantes[107] » et textes, le biote en tant que vivre ensemble. Ces formes puisent de fait à une même source : la musique. « En s’inspirant de la notation musicale et chorégraphique, […] la matrice graphique du modèle est une partition qui ouvre de nombreuses interprétations et invite à anticiper, court-circuiter, dévier, accélérer, retarder, modeler, reprendre […].[108] » Mais Barthes offre un supplément de connaissance : il range l’idiorrythmie dans une ontologie affective à travers laquelle il peut préciser la portée politique d’un tel mode d’être. En tant qu’écrivain, peut-être davantage et autrement que ne le ferait un scientifique ou bien un artiste, Barthes y voit une utopie : « une forme médiane, utopique, édénique, idyllique[109] ».
***
Au chapitre V de leur Mémo sur la nouvelle classe écologique, Bruno Latour et Nikolaj Schultz appellent à un « désalignement des affects[110] » modernes par une « redéfinition des affects liés à la liberté[111] », exigence qui est « inévitable et constamment retardée[112] ». La nouvelle « classe écologique », poursuivent-ils, « manque cruellement d’une esthétique capable de nourrir [d]es passions politiques […][113] ». S’il y a bien une politique esthétique de l’idiorrythmie, l’un de ses postulats est que la réciproque est impossible : une nouvelle aisthésis capable de remplacer les passions politiques actuelles, en général, par d’autres, nous semble impossible. Ce qui est impossible c’est bien la généralisation – ou bien, revenant à Barthes, la grégarisation d’une esthétique idiorrythmique. Car à ce niveau-là, le rythme redevient pouvoir, il cesse d’être rhuthmos. A la différence du succès en politique, la validation d’un mode esthétique ne dépend pas seulement de la quantité de vivants mobilisés, mais aussi de l’intensité qu’une mobilisation restreinte peut avoir sur la création de nouvelles formes de vie. C’est pourquoi, précédée par une bonne tactique d’exemption du sens, une nouvelle rythmologie pourrait donner naissance au contemporain écologique : à condition, pourtant, que toute cela soit une action restreinte.
Notes
- Neil Badmington, The Afterlives of Roland Barthes, London, Bloomsbury, 2016 ; Sunil Manghani, « Neutral Life: Roland Barthes’ Late Work – An Introduction » dans Theory, Culture & Society, vol. 37, no 4, p. 1-32, 2020. ↑
- Magali Nachtergael, Roland Barthes contemporain, Paris, Max Millo, 2015. ↑
- Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?. Paris, Payot-Rivages, 2008, p. 8 ; François Noudelmann, « Le Contemporain sans époque, une affaire de rythme », dans Lionel Ruffel (dir.), Qu’est-ce que le contemporain ?, Paris, Cécile Defaut, 2010, p. 59-76. ↑
- À titre d’exemple : Antoine Compagnon, Les Cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990. ↑
- En guise de bibliographie, qu’on nous permette de mentionner un seul titre : Dominique Viart, Laurent Demanze (dir.), Fins de la littérature. Esthétique et discours de la fin, 2 tomes, Paris, Armand Collin, 2012. ↑
- C’est d’ailleurs la thèse de Andrew McNamara dans Surpassing Modernity: Ambivalence in Art, Politics and Society, Londres, Bloomsbury, 2018. ↑
- Henri Meschonnic, Modernité, Modernité, Paris, Gallimard, 1988. ↑
- Ibidem, p. 14, apud Bruno Péquignot, L’Émergence de la modernité, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2023, p. 73. ↑
- Roland Barthes, Œuvres complètes, tome V, Paris, Seuil, p. 676. Désormais, nous allons renvoyer à cette édition selon le sigle OC suivi de la tomaison. ↑
- Lionel Ruffel, Brouhaha. Les Mondes du contemporain, Paris, Verdier, 2016. Dans cet ouvrage, il oppose expressément le concept herméneutique du philosophe italien à une série de pratiques qui ne se laissent pas définir en tant qu’objets. ↑
- Dipesh Chakrabarty, The Climate of History in a Planetary Age, Chicago, University of Chicago Press, 2021. ↑
- Thèse proposée par Quentin Meillassoux, Après la finitude. Essai sur la contingence de la nécessité, Paris, Seuil, 2006. ↑
- Nous pensons certes à G. Vattimo (Editor), P. A. Rovatti (Editor) Il pensiero debole, Milano, Feltrinelli, 1983. L’ouvrage a été traduit en roumain en 1998, mais jamais en français. ↑
- C’est avec une épigraphe de Barthes que s’ouvre son essai de 2008 Qu’est-ce que le contemporain ? (Paris, Payot en traduction française) ouvrage dont Lionel Ruffel fait plus tard une lecture actualisante (dans ↑
- Giorgio Agamben, Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995. ↑
- Éric Marty, « Avant-propos » dans Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France, 1978. Transcription des enregistrements par Nathalie Lacroix et Eric Marty, Paris, Seuil, 2023, p. 33-35. ↑
- Samuel Estier, « L’exemption du sens : Barthes haïkiste », à lire sur https://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/le-contresens/sommaire-de-contresens/523-intensites-lexemption-du-sens-barthes-haikiste (page consultée le 16 avril 2023) ↑
- L’expression apparait dans le célèbre « La Mort de l’auteur », dans Roland Barthes, OC III, p. 44 (en anglais c’est le même syntagne qui apparait : « exemption of meaning » (à trouver ici : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://writing.upenn.edu/~taransky/Barthes.pdf, consulté le 6 janvier 2026). Elle date donc de 1967. ↑
- Ibidem. ↑
- Tiphaine Samoyault retrace les voyages de Barthes en 1966 : Barthes arrive pour la première fois au Japon un peu avant sa présence à Baltimore pour le colloque sur les « sciences de l’homme » qui allait lancer la French Theory. T. Samoyault, Roland Barthes, Paris, Seuil, p. 371. Ce qui apparaît à la lumière de ces informations, c’est qu’on peut désormais penser ensemble « mort de l’auteur » et expérience japonaise (détaillée, entre autres, en « exemption du sens », « haïku », « empire des signes » et, en fin de compte, « neutre »). ↑
- Pour une histoire de la parution de cet article, voir John Logie, « 1967: The Birth of “The Death of the Author” », dans College English, 7 (5), 2013, p. 493-512. ↑
- Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », OC III, p. 44. ↑
- OC III, p. 352. ↑
- Ibid. ↑
- Voir Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968 ↑
- Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010 ; voir aussi Kristin Ross, Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années soixante, Paris, Flammarion, 2006. ↑
- Estier, ibid. ↑
- Sur l’interprétation de l’Etranger en termes de tragédie et sur l’évolution des lectures camusiennes de Barthes, nous renvoyons à notre article « Y a-t-il un Roland Barthes “primitif” ? Les années 1940 : la correspondance avec Robert David et la Roumanie » dans la Revue Roland Barthes, no 2 , http://www.roland-barthes.org/revue.html. ↑
- Roland Barthes, Le Neutre. Notes de cours au Collège de France 1977-1978. Texte établi, annoté et présenté par Thomas Clerc, Paris, Seuil/IMEC, 2002, p. 171. Seconde édition (2023), p. 288. ↑
- Ibid., p. 32. ↑
- Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Paris, Payot, 2013 (trad. Olivier Mannoni), p. 58. ↑
- Barthes, Le Neutre, op. cit., p. 32. ↑
- Ibid, p. 38. ↑
- Ibid, p. 111. ↑
- Ibid., p. 178. ↑
- Idem ↑
- Voir Magali Bossi, Une formule voyageuse. Enquête sur les circulations, appropriations et reconfigurations françaises du haïku, Genève, MetisPress, 2025. ↑
- En 1973, selon Tiphaine Samoyault, op. cit., p. 637 ↑
- Roland Barthes, « L’Empire des signes », dans OC III, p. 407-8. ↑
- Lionel Ruffel, « Introduction » dans Lionel Ruffel, Qu’est-ce que le contemporain ?, op. cit., p. 22. ↑
- Ibid., p. 22-31. ↑
- « Cerises », chronique d’une série parue dans Le Nouvel Observateur du 18 décembre 1978 au 26 mars 1979. OC V, p. 629 ↑
- Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, Terra Forma, Manuel de cartographies potentielles, Paris, B42, p. 124. ↑
- Ibidem, p. 122. ↑
- Voir l’entretien « Lectures d’enfance », dans OC V, p. 946-951. Voir, à ce propos, le chapitre de Ralph Heyndels, « Écoute… Au Palace ce soir ou le je-ne-sais-quoi et le presque-rien des ‘musiques’ », dans Claude Coste et Sylvie Douche, Barthes et la musique, Rennes, PUR, p. 117-133. ↑
- A. Matei, « Roland Barthes : pour une écologie de l’écriture », dans Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics 22 (2), 2020, p. 125-138. ↑
- Roland Barthes, « Le Plaisir du texte », OC IV, p. 219. Il s’agit du « texte de plaisir, [la] Babel heureuse ». ↑
- Ibidem, p. 220 ↑
- Ibidem, p. 226 ↑
- Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France 1978-79 et 1979-80, Paris, Seuil, 2015, p. 152. ↑
- Roland Barthes, « Le Plaisir du texte », OC IV, p. 226. ↑
- Roland Barthes, La Préparation du roman, op. cit., p. 66 ↑
- Barthes Roland, « Roland Barthes par Roland Barthes », OC IV, p. 730. ↑
- « Chansons populaires du Paris d’aujourd’hui », cours du 17 mai 1948, dans Fonds Barthes Chemise 2 BRT 2 Boîte 1 Cours de musique. ↑
- Yves Citton le voit parfaitement dans « Attentio practica : la flèche du temps à l’âge du faire », in Claude Coste et Sylvie Douche, Roland Barthes et la musique, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 185-201 p. 197 : « Faut-il pour autant classer Roland Barthes au rang des anti-modernes ? Le ralentissement qu’il promeut est peut-être tout aussi profondément futuriste qu’apparemment réactionnaire. » ↑
- P. Mougin, op. cit., p. 269-270. ↑
- Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, 2011, p. 20 ↑
- Découvert en 1973, son nom apparaît pour la première fois dans l’entrée « écoute » rédigée pour l’Encyclopédie Einaudi, en 1977 (OC V, p. 351) ↑
- Nous pensons ici d’abord à Michel de Certeau, dont la première édition de L’Invention du quotidien date de 1980 (Paris, UGE) et le passage en poche (Folio, Gallimard) de 1990. En complément à l’observation de la dimension visible des pratiques de régulation des lieux urbains, voir Bruno Latour, Emilie Hermant, Paris, ville invisible, Paris, éditions B42, 2021 [1998]. ↑
- Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte, 1999 ↑
- OC V, p. 918 ↑
- F. Noudelmann, dans Claude Coste et Sylvie Douche, op. cit., p. 54. ↑
- F. Noudelmann, dans L. Ruffel (dir.), op. cit., p. 59-76. ↑
- Roland Barthes, « Le Degré zéro de l’écriture », OC I, p. 213. ↑
- John C. Lapp, « Montaigne’s « Négligence » and Some Lines from Virgil », Romanic Review, Vol. 61, No 3, octobre 1970. ↑
- Voir l’article de Adrien Chassain, « Roland Barthes : “Les pratiques et les valeurs de l’amateur”, dans Fabula LHT, no 15, 2016, https://www.fabula.org/lht/15/chassain.html. ↑
- Roland Barthes, « Musica practica » dans OC V p. 447-8. ↑
- Roland Barthes, « Vingt mots-clés pour Roland Barthes », dans OC IV, p. 861. ↑
- Il s’agit d’une exposition qui sera ouverte à la Cité de l’art contemporain le 7 février 2026, avec Ėlodie Royer pour commissaire, qui « vise à rendre tangibles les relations et les liens qui nous unissent à notre environnement, liens qui sont devenus de plus en plus précaires et précieux, car nos modes de vie modernes ont entraîné de nombreuses perturbations environnementales » Voir https://fracsud.org/L-Ecologie-des-relations-1957. ↑
- Le terme est la traduction française du concept anglais de mesh : « l’interconnectivité entre toutes les choses vivantes et non vivantes ». Timothy Morton, La Pensée écologique, Paris, Zulma, 2019, p.56. Traduction de Cécile Wajsbrot. ↑
- Roland Barthes, « Cette vieille chose, l’art », texte paru dans Pop art. Evoluzione di una generazione, catalogue de l’exposition (Venise, 22 mars-6 juin 1980), Ed. Electa, 1980 et repris dans OC V, p. 921-922. ↑
- Le livre éponyme de Harold Rosenberg date de 1972 (The De-Definition of Art, Chicago University Press, 1972). ↑
- Nous renvoyons à l’ouvrage de Jerome Klinkowitz, Rosenberg/Barthes/Hassan: The Postmodern Habit of Thought, Athens, Georgia, University of Georgia Press (seconde édition en 2012). ↑
- Cette traduction française de l’anglais « empowerment » prend parfois d’autres formes : « encapacitation » ou bien « empouvoirement » qui nous ont paru moins précis. ↑
- Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, p. 118. ↑
- Roland Barthes, « Lettre du 28 mars 1942 à Jacques Veil », Album, op. cit., p. 50. ↑
- Roland Barthes, « Fatalité de la culture, limites de la contre-culture », entretien réalisé par Jean Dufflot et publié dans Politique-Hebdo en janvier 1972, repris dans OC IV, p. 195. ↑
- Roland Barthes, « L’Empire des signes », dans OC III, p. 427-8. ↑
- Emanuele Coccia, La Vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Paris, Payot-Rivages, p. 42 ↑
- Ibidem, p. 30. ↑
- Comme c’est le cas chez Henri Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Paris, Verdier, 1982. ↑
- Giorgio Agamben, Homo Sacer (1997-2015): L’intégrale, Paris, Seuil, 2016, p. 1305. ↑
- Ibid., p. 1171. ↑
- Notion qui apparaît chez Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse. Introduction à la connaissance des rythmes, Paris, Syllepse, 1992, reprise dans S. Manghani, Sunil, « Idiorrhythmy: An (unsustainable) aesthetic of ethics » dans Paola Crespi and S. Manghani (eds), Rhythm and Critique, Edinburgh, Edinburgh University Press, p. 153. ↑
- Barthes OC IV, p. 730 ↑
- Barthes, Comment vivre ensemble, op. cit., p. 38. ↑
- A. Morpurgo Davies, « Review of (C.) Sandoz, Les noms grecs de la forme : étude linguistique. [Thèse] (Inst. Sprachwiss. Bern: Arbeitspapiere, 6.) Berne, Institut für Sprachwissenschaft. 1972 », dans The Journal of Hellenic Studies, Vol. 94 , Novembre 1974 , p. 208-209. ↑
- Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, op. cit., p. 630. ↑
- Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, II. Paris, L’Arche, 1961, p. 177. ↑
- Yves Citton, art. cit. dans Sylvie Douche et Claude Coste, op. cit., p. 192. ↑
- Roland Barthes, « L’œuvre comme volonté », dans La Préparation du roman, Paris, Seuil, 2015, p. 237-265. Notamment « J’écris parce que j’ai lu », p. 242. ↑
- Une version de cette écologie discursive peut être retrouvée chez Bruno Latour, « Politiques de l’explication : une alternative » dans Ecritures no 10, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018, p. 15-48 ↑
- Sur l’ontologie de Gaïa : Bruno Latour et Timothy Lenton, « Extending the Domain of Freedom, or Why Gaïa is So Hard to Understand », dans Critical Inquiry, Vol. 45, No 3, Printemps 2019, 659-680. ↑
- Bruno Latour, Face à Gaïa: Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, p. 104. ↑
- « Gaïa, la hors-la-loi, c’est l’antisystème » : B. Latour, ibid., p. 105. ↑
- Roland Barthes, dans un entretien publié aux Etats-Unis en 1977, dans OC V, p. 737. (Nous soulignons.) ↑
- Roland Barthes, Le Neutre, op. cit., 2002, p. 60. ↑
- C’est pourquoi Latour a publié deux textes dans lesquels il s’efforce de surmonter les limites du langage pour dire Gaïa : « Why Gaia is not a God of Totality », dans Theory, Culture & Society, Vol. 34(2–3), 2017, p. 61–81 et (co-écrit avec Timothy M. Lenton), « Extending the Domain of Freedom, or Why Gaia Is So Hard to Understand », Critical Inquiry no 45 (Spring 2019), p. 659-680. ↑
- Latour, Face à Gaïa, op. cit. p. 54. ↑
- Barthes, Le Neutre, op. cit., p. 92. ↑
- Une « utopie du temps », écrit Barthes dans une Préface à un ouvrage de Jean Daniel, Le Refuge et la source (Gallimard, 1979), texte repris dans OC V, p. 312. ↑
- « dans un état d’irrésolution, c’est-à-dire en puissance de certaines transformations face à certaines rencontres » : Baptiste Morizot, Estelle Zhong Megual, Esthétique de la rencontre. L’Enigme de l’art contemporain, Paris, Seuil, 2020, p. 77. Le terme date de la fin XIXe siècle, par le chimiste Wilhelm Friedrich Ostwald (prix Nobel de chimie en 1909). ↑
- Barthes, Préparation, op. cit., « Séance du 2 février 1980 », p. 442-473. ↑
- Barthes, Comment vivre ensemble, op. cit., p. 39. ↑
- Idem ↑
- Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, Terra Forma, op. cit., p.124 ↑
- Ibid., p. 13. ↑
- Ibid., p.122 ↑
- Barthes, Comment vivre ensemble, op. cit., p. 40. ↑
- Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, La Découverte, 2022, p. 39. ↑
- Ibid.,p. 41. ↑
- Ibid., p. 45. ↑
- Ibid., p. 46. ↑