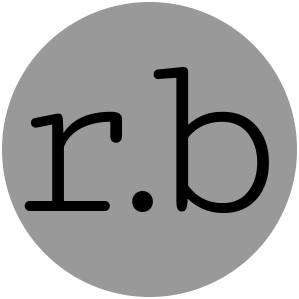La tâche de cet article est double, herméneutique et comparative à la fois : il s’agit d’abord de préciser le sens d’une notion programmatique utilisée sporadiquement par Roland Barthes, et puis de mettre en parallèle cette notion-là avec d’autres idées théoriques proposées aux XXe et XXIe siècles.
La « philologie active », évoquée par Barthes dans plusieurs textes datant tous des années 1976-1977, fait partie des nombreuses sciences imaginaires qu’il aimait à projeter. La plus connue est peut-être la « science de la littérature », postulée dans Critique et vérité (1966), avec cette réserve caractéristique : « si elle existe un jour »[1] ; Roland Barthes par Roland Barthes (1975) dresse toute une liste de disciplines inédites et plus ou moins utopiques que l’auteur aurait l’intention de développer :
[…] une Histoire de l’écriture, une Histoire de la rhétorique, une Histoire de l’étymologie, une Stylistique nouvelle, une Esthétique du plaisir textuel, une nouvelle science linguistique, une Linguistique de la valeur, un inventaire des discours d’amour, une Fiction fondée sur l’idée d’un Robinson urbain, une Somme sur la petite-bourgeoisie […][2].
Ailleurs dans le même livre, il y ajoutait une « linguistique de l’intimidation (de la Valeur, de la guerre des sens) » qui anticipe de peu la « philologie active »[3]. Parmi les textes où celle-ci est nommée de son propre nom, il y a d’abord Fragments d’un discours amoureux (1977) :
Cette œuvre [Le Banquet de Platon. – S.Z.] relève donc de deux linguistiques, ordinairement refoulées – puisque la linguistique officielle ne s’occupe que du message. La première postulerait que nulle question (quæstio) ne peut se poser sans la trame d’une interlocution ; pour parler de l’amour, les convives non seulement parlent entre eux, d’image à image, de place à place (dans Le Banquet, la disposition des lits a une grande importance), mais encore impliquent dans ce discours général les liens amoureux dans lesquels ils sont pris (ou imaginent que les autres sont pris) : telle serait la linguistique de la « conversation ». La seconde linguistique dirait que parler, c’est toujours dire quelque chose de quelqu’un ; en parlant du Banquet, de l’Amour, c’est de Socrate, d’Alcibiade et de leurs amis, que Glaucon et Apollodore parlent : le « sujet » vient au jour par le potin. La philologie active (celle des forces du langage) comprendrait donc deux linguistiques, obligées : celle de l’interlocution (parler à un autre) et celle de la délocution (parler de quelqu’un)[4].
X… me rapporte une rumeur désagréable qui me concerne. Cet incident retentit en moi de deux manières : d’une part, je reçois à vif l’objet du message, m’indigne de sa fausseté, veux démentir, etc. ; d’autre part, je perçois bien le petit mouvement d’agressivité qui a poussé X… – sans qu’il le sache trop lui-même – à me rapporter une information blessante. La linguistique traditionnelle n’analyserait que le message : à l’inverse, la Philologie active chercherait avant tout à interpréter, à évaluer la force (ici réactive) qui le dirige (ou l’attire)[5].
Et dans les conférences au Collège de France, Comment vivre ensemble (1976-1977) :
À ce sujet, je dois préciser ceci : une théorie (en ce sens nouvelle) de la lecture est possible (lecture contre-philologique). Lire en s’abstrayant du signifié : lire les Mystiques sans Dieu, ou Dieu comme signifiant […][6].
Enfin : la philologie (ou la pseudo-philologie) est lente[7].
Le sujet lecteur, auditeur, a un rapport différentiel aux mots en fonction de leurs référents. Ce serait là une voie de recherche de la philologie active, voulue par Nietzsche : philologie des forces, des différences, des intensités[8].
On voit que la philologie active est pour Barthes non seulement utopique, mais surtout polémique (c’est pourquoi il parle d’une « lecture contre-philologique » et d’une « pseudo-philologie »). En effet, généralement le mot philologie a mauvaise réputation chez lui. Il considère ladite discipline comme une citadelle du conservatisme universitaire, à la garde d’un sens unique d’un mot ou d’un texte. Les définitions communes semblent corroborer cette idée :
PHILOLOGIE. Science qui embrasse diverses parties des belles-lettres sous le rapport de l’érudition, de la critique et de la grammaire[9].
PHILOLOGIE. Science qui étudie les documents écrits, et en particulier les œuvres littéraires, du point de vue de l’établissement des textes, de leur authenticité, de leurs rapports avec la civilisation et l’auteur, et qui étudie aussi l’origine des mots et leur filiation[10].
Les deux définitions citées diffèrent par leurs dates et leurs visées intellectuelles : celle d’un vieux dictionnaire académique se contente de lier la philologie à d’autres savoirs (« l’érudition, la critique et la grammaire ») ; celle d’un dictionnaire contemporain de Barthes, et qui prend en compte les acquis de la linguistique moderne, distingue les tâches et les opérations effectuées sur le langage (établir l’authenticité des textes, mettre ceux-ci en rapport avec « la civilisation et l’auteur »). Ainsi comprise – ainsi est-elle comprise en France, à la différence des pays comme l’Allemagne ou la Russie – la philologie laisserait de côté la théorie de la littérature, qui prend en compte la multiplicité des sens. Barthes a déclaré plus d’une fois son opposition à cette philologie-là. Par exemple dans Critique et vérité :
C’est pourquoi les règles de la lecture ne sont pas celles de la lettre, mais celles de l’allusion : ce sont des règles linguistiques, non des règles philologiques.
La philologie a en effet pour tâche de fixer le sens littéral d’un énoncé, mais elle n’a aucune prise sur les sens seconds. Au contraire, la linguistique travaille, non à réduire les ambiguïtés du langage, mais à les comprendre, et, si l’on peut dire, à les instituer[11].
L’objectivité requise par cette nouvelle science de la littérature portera, non plus sur l’œuvre immédiate (qui relève de l’histoire littéraire ou de la philologie), mais sur leur intelligibilité[12].
Ou dans Roland Barthes par Roland Barthes :
[La notion d’intertexte] n’est qu’une petite machine de guerre contre la loi philologique, la tyrannie universitaire du sens droit[13].
Si la philologie a pour tâche d’établir le sens littéral d’un énoncé, la linguistique, dont les découvertes servent d’appui à Barthes, cherche à ne pas éliminer les ambiguïtés, mais à les comprendre et « instituer ». De même l’inédite « science de la littérature » aura pour objet, non l’œuvre comme une donnée immédiate (qui appartient à l’histoire littéraire et à la philologie), mais son intelligibilité, c’est-à-dire sa polyvalence sémantique, la pluralité de ses interprétations possibles. La philologie s’occupe du message et cherche à établir un sens univoque, tandis que la nouvelle science, voulue par Barthes, explorera les potentialités de sens variables.
D’où résultent ces potentialités ? Cette question me conduit à examiner l’interprétation de l’idée barthésienne de philologie active, proposée récemment par Shane Weller[14]. Ce chercheur signale d’abord l’origine nietzschéenne de cette idée – à juste titre, reprenant une référence déjà citée de Barthes (« la philologie active, voulue par Nietzsche »). Il fait ensuite un constat important que « [w]hile Nietzsche makes various remarks on philology […] he does not refer at any point explicitly to an “active philology” »[15], que cette formule n’est pas de lui. Shane Weller établit également que « Barthes’s Nietzsche was highly mediated »[16] par d’autres philosophes, et notamment par Gilles Deleuze, dont Barthes a lu Nietzsche et la philosophie (1962) « bien après » sa publication[17]. Voici comment Deleuze définit la « philologie active » dans cet ouvrage-là :
[…] on a l’habitude de juger du langage du point de vue de celui qui entend. Nietzsche rêve d’une autre philologie, d’une philologie active. Le secret du mot n’est pas plus du côté de celui qui entend, que le secret de la volonté du côté de celui qui obéit ou le secret de la force du côté de celui qui réagit. La philologie active de Nietzsche n’a qu’un principe : un mot ne veut dire quelque chose que dans la mesure où celui qui le dit veut quelque chose en le disant. Et une seule règle : traiter la parole comme une activité réelle, se mettre au point de vue de celui qui parle[18].
S’appuyant sur ces textes de Barthes et Deleuze, Shane Weller conclut que la philosophie active de Barthes serait une attitude « nihiliste », à l’encontre du souci philologique d’un sens défini :
[…] Barthes’s active philology is itself nihilistic […] Active philology is, in short, a form of active nihilism, directed towards a cancellation of meaning rather than a simple proliferation of meanings[19].
La philologie active, ainsi comprise, serait une certaine écriture, définie par l’emploi des « concepts-métaphores » et par la fragmentation de textes. Évitant tout sens univoque, cette philologie-écriture serait la même chose que le Texte ; or l’idée de Texte a été avancée par Barthes quelques années plus tôt, au début des années 1970, et le dernier livre de Barthes, La Chambre claire (1980), n’est précisément pas fragmentaire. La lecture proposée par Shane Weller est une interprétation « post-moderne » de la notion barthésienne. Est-elle correcte ?
Le mot actif peut, si on le comprend de la manière la plus commune, signifier « qui agit », et alors la philologie active serait définie par l’action qu’elle produit sur son objet (texte), par son acte de former ou déformer cet objet. Or, on ne trouve cette acception-là du terme dans aucun texte de Barthes. Il répète que la philologie active est « une philologie des forces », mais elle n’est pas pour autant destinée à appliquer elle-même la force, elle « chercherait avant tout à interpréter, à évaluer la force » d’un énoncé produit par un sujet. Le mot philologie, même en prenant l’épithète active, ne s’éloigne pas trop de son sens ordinaire : interprétation, et non production des textes.
Certes, le mot actif conserve chez Barthes une nuance sémantique héritée de Nietzsche (et de l’ouvrage de Deleuze sur ce dernier) : actif s’oppose à réactif, le premier terme impliquant des initiatives indépendantes et le second, des réponses stimulées par d’autres. Barthes se servait bien de cette opposition, quelquefois en se l’appliquant à lui-même[20] ou à d’autres comme dans ce passage déjà cité où il évoque la philologie active :
[…] je perçois bien le petit mouvement d’agressivité qui a poussé X… – sans qu’il le sache trop lui-même – à me rapporter une information blessante […] la Philologie active chercherait avant tout à interpréter, à évaluer la force (ici réactive) qui le dirige (ou l’attire).
Les exemples en disent souvent long sur la teneur des catégories abstraites qu’ils illustrent. Ainsi, pour expliquer l’idée de philologie active, Barthes choisit un souvenir de sa propre vie. Dans l’épisode en question, X…, mû par une force « réactive » (un ressentiment peut-être, souvent condamné par Nietzsche ?) rapporte une nouvelle « blessante » à Barthes. Mais qui est en position active dans cet épisode ? Roland Barthes, l’interlocuteur de X…, ne produit aucun acte, il ne fait que recevoir le message qu’on lui adresse. Or il devient un philologue actif en analysant le propos de X…, en le mettant entre parenthèses. D’un simple interlocuteur, il devient psychanalyste, sémiologue… et philologue, car il interprète des mots. Le caractère spécifiquement actif de son attitude ne réside pas dans le simple fait d’interpréter (toute philologie fait de même) mais dans son attention particulière à la « force (ici réactive) » qui détermine le propos de l’autre. La philologie active est celle qui prend en considération « les forces du langage » de l’autre, ce qu’il veut (Deleuze), son langage en acte, son langage comme acte (en l’occurrence un acte réactif).
L’autre exemple pris au même livre de Barthes (Fragments d’un discours amoureux) est encore plus éloquent. Il s’agit du Banquet de Platon, un objet séculaire d’interprétations philologiques. Pour rendre compte de ce dialogue, dit Barthes, la philologie active, sans se contenter d’analyser les messages échangés (ce que font la philologie ordinaire et « la linguistique officielle »), doit étudier les relations, par exemple amoureuses, entre les interlocuteurs et le rapport de leurs paroles à leur « référent » (en l’occurrence, Socrate). Suivant ces deux axes, l’étude du texte dépasse les traits grammaticaux et sémantiques des mots pour tenir compte des désirs de ceux qui échangent les répliques. Elle transforme un échange d’idées abstraites sur l’amour en une scène théâtrale régie par des rapports amoureux. La philologie active explore l’activité (ou réactivité) qui résulte de ces rapports.
Ce faisant, elle retient le sens nietzschéen du mot actif : souverain, indépendant. Deleuze, dans sa lecture de Nietzsche, voulait que cette philologie adoptât le point de vue de celui qui parle et non de celui qui écoute. Il entendait par là que le locuteur était actif et l’auditeur, passif (peut-être pas même réactif) – celui-là domine, celui-ci se soumet. Même si l’auditeur interprète à tort et à travers les propos qu’il entend (on sait combien le cas est fréquent), sa force reste réactive, dépendante de ce que lui dit l’autre. Barthes, quant à lui, ne reprend pas à Deleuze la réduction de l’opposition nietzschéenne des deux forces à l’opposition des deux linguistiques, celle d’écoute et celle de locution. La souveraineté active de sa philologie ne résulte pas du fait qu’elle parle ou écrit mais de ce qu’elle va au-delà des mots vers les actes de langage. Elle vise un « sens » spécial : celui d’un acte d’énonciation, qui ne coïncide pas avec le message énoncé.
La prise en considération de ce caractère double du sens modifie l’objet de la philologie active. Différente en cela de l’écriture littéraire, celle-ci ne cherche pas à évacuer le sens : Barthes a d’ailleurs remarqué déjà dans un entretien de 1963 que « “néantiser” le sens est un projet désespéré […] [p]arce que le “hors-sens” est immédiatement absorbé […] dans le non-sens, qui, lui, est bel et bien un sens (sous le nom d’absurde) »[21], c’est-à-dire un nouveau signifié. Elle ne multiplie non plus les sens d’un texte dans une sorte de jeu arbitraire, car la pluralité des sens est déjà là dans le texte, résultant d’un décalage entre l’énoncé et l’énonciation, et d’intentions différentes des sujets de communication. L’acte de communication comprend toujours au moins deux participants, disposant d’une force discursive et produisant des ou du sens (à la locution comme à l’écoute).
Compte tenu de ces arguments, la philologie active selon Barthes doit se caractériser comme une « science », et non une « littérature » ; le passage de celle-là à celle-ci, déclaré dans l’article éponyme de 1967 n’a jamais été complet, et l’élection de Barthes au Collège de France en 1976 pouvait aviver en lui une conscience « scientifique ». Le projet de philologie active en témoigne : c’est un mode de connaissance plutôt que de création, et qui se définit par un objet spécifique, la structure des forces à l’œuvre dans un énoncé verbal. Au lieu de « néantiser » le sens, la philologie active cherche plutôt à l’élargir, à comprendre non seulement le sens des mots (unique et dénotatif ou pluriel et connotatif) mais aussi celui des actes de langage.
Pour la philologie traditionnelle, c’est une attitude discutable. L’un des classiques de la philologie russe du XXe siècle, Sergey Averintsev, a lancé une définition-slogan qui a fait fortune : « La philologie est un service de compréhension »[22]. Or, son compatriote Mikhail Iampolski a avancé plus tard une thèse contraire : la philologie est « une science de non-compréhension »[23], qui déconstruit le sens intégral d’un texte pour y découvrir une pluralité de discours convergents ; elle a affaire aux débris, aux ruines de sens. Iampolski illustre sa thèse par l’histoire de la philologie allemande du XIXe siècle, dont Nietzsche est le personnage principal. Philologue de formation, après avoir enseigné les lettres classiques à l’université de Bâle, Nietzsche a voulu faire de la philologie active, explorant les rapports de pouvoir dans la communication textuelle, ce qui l’a conduit à une rupture éclatante avec l’ancienne tradition philologique. Comme celle-ci, la philologie des forces s’occupe à comprendre mais ce terme peut s’entendre de deux manières différentes : comprendre un mot, un signe ou un texte n’est pas la même opération intellectuelle que comprendre une action, le comportement d’une personne ou la logique des événements qui lui arrivent.
Que peut-on opposer à la philologie traditionnelle comme compréhension purement sémantique ? Quels courants, quelles théories en sciences humaines peuvent converger avec la philologie active rêvée par Barthes ? Sa source la plus proche et la plus évidente était sans doute l’idée sartrienne de « situation » dans laquelle doit se comprendre tout texte littéraire. La situation, notamment la situation politique, rend responsable un auteur, en déterminant, comme l’expliquait Barthes dans Le Degré zéro, son écriture. Mais ni Sartre, ni le premier Barthes n’ont parlé d’une manière si marquée de la force transformatrice sous-jacente à une écriture ; la philologie active fait donc penser à d’autres parallèles, éventuellement inconnus de son inventeur.
Il y a d’abord, facile à deviner, la théorie anglo-saxonne des actes de parole (speech acts). Rien n’indique que Barthes ait été familier avec elle (le nom de J. L. Austin n’apparaît que très brièvement dans ses textes), mais cette théorie a presque le même objet que la philologie active, à savoir l’intention de celle ou celui qui parle/écrit, son vouloir-produire quelque chose par son discours. Il est vrai que selon Austin, des conditions spéciales sont requises pour réaliser cette intention : une situation plus ou moins fixe et rituelle, le sérieux des participants, etc. Pour Barthes, l’objet de la philologie active se définirait plus largement : inclut-il par exemple l’œuvre littéraire, qui a souvent une nature ludique et improvisée ? En tout cas, même si Barthes n’avait pas de connaissance approfondie de la théorie des actes de parole, il s’intéressait bien à certains actes particuliers : ainsi J. Hillis Miller relève-t-il chez lui l’analyse d’un cas exemplaire de speech act performatif – l’holophrase Je-t-aime, et ceci dans Fragments d’un discours amoureux, le même ouvrage où Barthes introduit la notion de philologie active[24].
Quant aux « intensités » énergétiques qui sont l’un des objets de la philologie active selon Barthes, on en trouve une intuition chez les formalistes russes. Iouri Tynianov, dans son article fondamental « Le fait littéraire » (1924)[25], notait que l’identification historique d’un genre – par exemple, d’un long poème narratif – dépendait de sa longueur, autrement dit de sa capacité énergétique :
La « grandeur » est, au départ, une notion énergétique : nous sommes enclins à appeler « grande forme » une forme dont la construction exige une grande énergie[26].
Là où Barthes parle de « force », le théoricien russe préférait la notion assez proche quoique différente d’énergie ; en physique, celle-ci est conçue comme scalaire, déterminée par sa seule valeur quantitative, et celle-là comme vectorielle, définie par sa valeur quantitative plus le sens de son action. Les forces interagissent en fonction non seulement de leur intensité, mais aussi des directions dans lesquelles elles convergent ou divergent. La philologie active chez Tynyanov était une philologie des valeurs scalaires, elle évaluait la capacité énergétique d’une forme littéraire (certaines formes en ont une plus grande que d’autres), sans se demander dans quelle direction cette énergie se reverserait, quel serait son effet, et sur qui ou sur quoi il serait produit. Barthes veut prendre en considération précisément cette nature vectorielle de la force : l’énergie de communication affecte quelqu’un, provenant de quelqu’un d’autre. Dans l’évolution d’une culture on peut donc relever non seulement des différences statiques d’énergie (un objet culturel étant plus chargé qu’un autre) mais aussi des interactions, des conflits.
Une critique de la philologie traditionnelle qui converge avec celle faite par Barthes se trouve dans le livre du linguiste soviétique Valentin Volochinov Marxisme et philosophie du langage (1929), peut-être écrit en collaboration avec Mikhail Bakhtine[27]. Selon Volochinov, l’attitude philologique, héritée par la linguistique structurale du XXe siècle, prend son origine dans l’étude des langues mortes et étrangères d’après des textes écrits :
À la base des méthodes linguistiques de réflexion qui conduisent à concevoir la langue comme un système de formes normativement identiques, on trouve l’étude pratique et théorique des langues étrangères mortes conservées dans des documents écrits.
Il faut insister sur le fait que cette orientation philologique a déterminé en grande partie toute la réflexion linguistique du monde européen. Cette pensée s’est constituée et a mûri sur les cadavres des langues écrites : c’est dans l’exhumation de ces cadavres qu’ont été élaborées presque toutes les catégories fondamentales, toutes les approches fondamentales et les habitudes de cette pensée[28].
La philologie traditionnelle s’obstinerait donc à étudier des objets inertes, incapables de produire une action énergétique ; pour nous, ils sont précisément des objets, qu’on observe, identifie et soumet à l’analyse. Par contre la science moderne du langage, postulée par Volochinov, devrait s’occuper des actes d’énonciation, qui contiennent non seulement un texte mais aussi un désir de dire quelque chose, une possibilité de se comprendre – et d’agir par cela sur quelqu’un, ajouterait Barthes.
La critique contemporaine redéfinit ses rapports avec la philologie en mettant en question sa préoccupation générale du sens. Elle s’oppose à l’herméneutique, à la prédominance du sens et de son interprétation dans les études de la littérature et de l’art. Susan Sontag écrivait déjà dans les années 1960 qu’au lieu de l’herméneutique, on avait besoin d’une « érotique de l’art », portant sur les désirs évoqués et éveillés par les œuvres[29]. Plus tard, Jean-Luc Nancy se disait irrité par les nombreux discours cherchant à « faire un peu plus de sens » :
A moment arrives when one can no longer feel anything but anger, an absolute anger, against so many discourses, so many texts that have no other care that to make a little more sense, to redo or to perfect delicate works of signification[30].
L’interprétation du sens n’est donc qu’un premier degré d’étude, précédant la compréhension de la présence de l’œuvre et de l’action qu’elle produit. Le théoricien germano-américain Hans Ulrich Gumbrecht soutient cette position, malgré les éventuelles implications métaphysiques de celle-ci :
[…] there is probably no way to end the exclusive dominance of interpretation, to abandon hermeneutics and metaphysics in the humanities without using concepts that potential intellectual opponents may polemically characterize as « substantialist », that is concepts such as « substance » itself, « presence », and perhaps even « reality » and « Being »[31].
Si les concepts philosophiques que Gumbrecht prend le risque d’introduire en philologie se laissent quantifier, ils ont eux aussi une nature scalaire plutôt que vectorielle. Ils caractérisent l’Être qui investit des objets culturels plutôt que leur interaction. Tout en s’écartant de la philologie du sens, ce programme de recherche ne coïncide pas pour autant avec la philologie des forces.
Enfin, une éventuelle sortie de la philologie traditionnelle vers la philologie active passerait par la mimesis. Dans les études littéraires celle-ci se comprend le plus souvent comme l’imitation d’une réalité – de la nature, des caractères, de leur apparence et leurs rapports. Or, les sociologues et anthropologues pratiquent depuis longtemps une autre idée de l’imitation, qu’ils définissent comme une entre-imitation des individus, des foules et des groupes sociaux. Dans les lettres et les arts, ce phénomène correspond à l’impact énergétique du locuteur sur l’auditeur, de l’artiste sur le spectateur/lecteur/auditeur. Les moyens verbaux de cette action seraient le rythme poétique[32], l’immersion fictionnelle, l’effet de défamiliarisation esthétique. Le critique russe émigré Vladimir Weidlé dans l’article publié en allemand « Sur la signification de la mimesis » (1963)[33] définissait celle-ci comme un processus, pas un état, une production, pas un produit. Déjà le chef de file des formalistes russes Victor Chklovski disait, en évoquant l’opposition humboldtienne energeia/ergon en linguistique, que dans l’art seul importe le faire, et ce qui est fait ne compte pas. Ce « faire » peut se comprendre comme une activité mimétique mettant en scène « des forces, des différences, des intensités », pour reprendre les mots de Barthes. Dans une mimesis ainsi interprétée, l’auteur transmet à son lecteur des pulsions psychiques, voire physiologiques, comme le rire ou l’horreur, il le charge d’une énergie et le pousse à imiter ces pulsions.
En clôturant cet aperçu fragmentaire et qui associe des théories et des approches différentes, on constatera l’essentiel : la philologie active, pour Roland Barthes, est une activité cognitive (et, somme toute, scientifique). Loin du « nihilisme », elle cherche la responsabilité des formes, qui a toujours intéressé Barthes[34] et qui n’est rien d’autre que le sens d’un discours considéré comme acte. Convergeant avec d’autres programmes avancés en sciences humaines, cette discipline imaginée va plus loin que la philologie grammaticale et sémantique, pour lui ajouter une étude des intentions (y compris inconscientes) de l’auteur, des forces qui dirigent son énonciation et qui peuvent influencer le lecteur. Le texte est un espace où se jouent ces forces, et il est responsable de ses effets énergétiques autant que sémantiques. Expliciter des rapports de forces sous-tendant les énoncés verbaux a été une tâche postulée par Nietzsche et une préoccupation majeure de Barthes critique et théoricien.
Notes
-
Roland Barthes, Œuvres complètes, tome 2, Paris, Seuil, 1994, p. 40. Dans la suite, les références à cette édition en trois volumes (1993-1995) seront abrégées : OC. ↑
- « Plus tard », OC, t. 3, p. 227. ↑
- « Projets de livres », OC, t. 3, p. 209. ↑
- « Le Potin », t. 3, OC, p. 629-630. Ici et dans la suite, les caractères gras dans les citations sont de moi, tandis que les italiques sont de l’auteur cité. ↑
- « Le Retentissement », OC, t. 3, p. 644. ↑
- Roland Barthes, Comment vivre ensemble, Paris, Seuil – IMEC, 2002, p. 43. ↑
- Ibid., p. 51. ↑
- Ibid., p. 149. ↑
- Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Firmin-Didot, 1883. ↑
- Dictionnaire Larousse Lexis, Paris, Larousse, 1979. ↑
- OC, t. 2, p. 39. ↑
- OC, t. 2, p. 43. ↑
- « Tactique/stratégie », OC, t. 3, p. 227. ↑
- Shane Weller, « Active Philology : Barthes and Nietzsche », French Studies, vol. LXXIII, no. 2, 2019, p. 217-233. ↑
- Ibid., p. 224. ↑
- Ibid., p. 222. ↑
- Ibid., p. 223. L’information vient de l’article de Barthes « À quoi sert un intellectuel ? » (1977). ↑
- Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, PUF, 1962, p. 84. ↑
- Weller, « Active Philology », art. cité, p. 232. ↑
- Comme dans ce premier fragment de Roland Barthes par Roland Barthes : « Dans ce qu’il écrit, il y a deux textes. Le texte I est réactif, mû par des indignations, des peurs, des ripostes intérieures, des petites paranoïas, des défenses, des scènes. Le texte II est actif, mû par le plaisir. Mais en s’écrivant, en se corrigeant, en se pliant à la fiction du Style, le texte I devient lui-même actif ; dès lors il perd sa peau réactive, qui ne subsiste plus que par plaques (dans de menues parenthèses) » (« Actif/réactif », OC, t. 3, p. 127). ↑
- « Littérature et signification », OC, t. 1, p. 1370. ↑
- Sergey Averintsev, « Philologie », dans Bolchaïa sovetskaïa entsiklopedia, t. 27, Moscou, 1977, p. 411. ↑
- Mikhail Iampolski, « La Philologie, une science de non-compréhension », dans Mikhail Iampolski, « Skvoz’ tuskloe steklo »: Dvenadtsat’ glav o neopredelennosti, Moscou, Novoe literaturnoe obozrenie, 2010, p. 207–223. ↑
- Voir J. Hillis Miller, Speech Acts in Literature, Stanford UP, 2002. ↑
- On ne sait pas si Barthes connaissait ce texte, qui ne faisait pas partie de l’anthologie des formalistes russes éditée par Tzvetan Todorov en 1965. ↑
- Iouri Tynianov, Formalisme et histoire littéraire, traduit par Catherine Depretto, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1991, p. 213. ↑
- On ne peut pas affirmer que Barthes connût cet ouvrage, dont la première traduction française parut en 1977, la même année que Fragments d’un discours amoureux. Le nom d’auteur y était marqué « Mikhail Bakhtine » (!), et l’on sait l’intérêt porté par Barthes aux idées de ce théoricien russe. ↑
- Valentin Nikolaevič Vološinov, Marxisme et philosophie du langage, édition de Patrick Sériot et Inna Tylkowski-Ageeva, Limoges, Lambert-Lucas, 2010, p. 264. ↑
- Susan Sontag, Against Interpretation, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1966. ↑
- Jean-Luc Nancy, The Birth to Presence, Stanford UP, 1994, p. 6. ↑
- Hans Ulrich Gumbrecht, Production of Presence: What Meaning Cannot Convey, Stanford UP, 2004, p. 53. ↑
- « Le rythme est l’énergie principale du vers » (Vladimir Maïakovski, Kak delat’ stikhi, Moscou, Sovetski pisatel’, 1951, p. 24). ↑
- Voir Vladimir Weidle, Embriologia poezii : Srat’i po poetike i teorii iskusstva, Moscou, Iazyki slavianskoi kultury, 2002. ↑
-
Voir Serge Zenkine, « La responsabilité de Roland Barthes », Revue Roland Barthes, 2018, n° 4. ↑