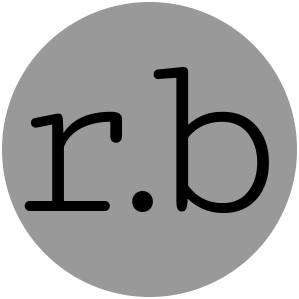Sont contemporaines deux personnes qui vivent à la même époque ou sont nées la même année (« Je ne crois pas qu’elle soit ma contemporaine », s’écrie Mme des Laumes – la future duchesse de Guermantes – en parlant de la jeune Mme de Cambremer !). Plus spécifiquement, le mot renvoie à une forme de proximité, affective ou intellectuelle. Ainsi, sont contemporaines deux personnes qui entretiennent une relation forte en partageant le même présent (Voltaire et Rousseau sont contemporains par leur dialogue philosophique) et parfois même en franchissant la frontière des siècles. Par la tuberculose et le sanatorium, Barthes se sent en 1977 le contemporain des personnages de La Montagne magique de Thomas Mann, qui vivent en 1913[1] ; quant à l’auteur-narrateur de La Frontière de Pascal Quignard, on se souvient qu’il écrit pour les lecteurs de 1640 !
Par la chronologie, Roland Barthes (né en 1915) et Albert Camus (né en 1913) sont quasiment contemporains. Les deux intellectuels et écrivains se sont lus, s’estimaient malgré leurs différences, mais pour ce qui est de la complicité ou du partage intellectuel, la situation est beaucoup plus compliquée. On distinguera trois étapes dans le dialogue direct ou indirect qui les relie. La première correspond à l’admiration de Barthes pour L’Étranger et pour son écriture blanche, une forme de « degré zéro » avant la lettre. Après « Réflexion sur le style de L’Étranger » (1944), un de ses premiers textes, écrit au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, Barthes réitère en 1954 son admiration pour le roman de Camus dans « L’Étranger, roman solaire ». L’œuvre y est cette fois-ci analysée comme une tragédie, avec le soleil pour destin : « le feu solaire fonctionne ici avec la rigueur même de la Nécessité antique[2]. » (OCI, 480)
Puis vient le temps de la polémique[3]. Elle éclate à propos de La Peste, roman pour lequel Barthes donne une préface en 1955[4]. Malgré un ton modéré, et parfois élogieux, la critique est double : Barthes, d’une part, regrette le choix d’une approche strictement morale de l’épidémie, d’autre part, il déplore que Camus soit passé à côté d’une véritable tragédie. Courtois et respectueux, l’échange se conclut par la persistance d’un profond désaccord entre les deux hommes. La troisième période correspond au silence. Si la mort de Camus en janvier 1960 met définitivement fin au dialogue direct, Barthes ne se réfère quasiment plus à son œuvre ; tout au plus trouve-t-on ici ou là quelques allusions toujours élogieuses à L’Étranger. Et pourtant, ce silence ou ce quasi-silence n’exclut pas une forme de contemporanéité qui se met progressivement en place à la fin des années 70. C’est ce dialogue, cette convergence inattendue que l’on voudrait faire entendre aussi – et surtout. Si Barthes semble ignorer Camus à partir des années 60, les deux intellectuels-écrivains retrouvent une grande proximité politique – dont témoigne, en particulier, le monumental Fichier conservé à la BnF[5].
Littéralité ou métaphore ?#
Au commencement donc l’admiration. Dans L’Étranger, Camus pratique, selon Barthes, une écriture blanche qui tient à distance la rhétorique, les belles lettres et tente (mais en vain) d’échapper à toutes récupérations idéologiques. Telle est la célèbre analyse que proposent l’article de 1944 et surtout Le Degré zéro de l’écriture en 1953. Le même souci de la littérarité se retrouve, en dépit des désaccords, dans la préface sur La Peste. Barthes y reproche à Camus de n’avoir pas su choisir entre le sens propre et le sens figuré, d’avoir confondu une maladie, qui relève de la médecine, et une catastrophe, qui renvoie à l’histoire. Peut-on, en effet, parler du nazisme comme d’une épidémie, dire le totalitarisme par le biais d’une métaphore (comme le fera Ionesco en 1959 avec Rhinocéros) ? Telle est la question rhétorique que pose Barthes à Camus :
le romancier a-t-il le droit d’aliéner les faits de l’histoire ? Est-ce qu’une peste peut équivaloir, je ne dis pas à une occupation, mais à l’Occupation ? […] je crois à un art littéral où les pestes ne sont rien d‘autre que des pestes, et où la Résistance, c’est toute la Résistance[6].
Il est difficile de ne pas donner d’abord raison à Barthes. Peste et nazisme n’appellent pas une réaction identique, on ne lutte pas de la même manière contre une épidémie et contre le fascisme ; bien plus, les causes diffèrent largement, même si tout fléau (peste ou tremblement de terre) renvoie à des réalités humaines autant que naturelles (santé publique, qualité de la construction, capacités d’anticipation…). Mauvais défenseur de sa propre poétique, Camus entretient la confusion dans le paratexte. Par exemple, l’épigraphe de La Peste appelle clairement à une lecture symbolique : « Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement par une autre que de représenter n’importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n’existe pas. (Daniel Defoe) » Dans sa réponse à Barthes, Camus assimile peste et nazisme, revendiquant la dimension allégorique de son œuvre[7]. Quant au roman lui-même, les passages concernant le marché noir ou les fours crématoires, même si le contexte est très différent, ne peuvent pas ne pas éveiller chez les lecteurs, et tout particulièrement les lecteurs de 1947, des souvenirs de la seconde guerre mondiale.
Force est pourtant de reconnaître que les analyses de Barthes manquent largement leur cible – quelle que soit la pertinence du point de vue théorique, et malgré l’aide volontaire ou involontaire de Camus. En effet, le roman n’est pas du tout allégorique et c’est bien une épidémie au sens propre qui nous est racontée : la peste présentée aux lecteurs est une peste littérale qui appelle une réponse médicale. Les symptômes, les traitements, les horreurs de la maladie et l’intensité de la souffrance, tout cela est montré sans complaisance et sans arrière-pensée. La peste selon Camus est tout aussi matérielle et presque aussi hideuse que celle décrite par Giono dans Le Hussard sur le toit (1951). Loin de toutes dimensions politiques, Camus s’en tient à une approche réaliste (description de l’épidémie) et morale (attitude des personnages). Dans leur grande discussion finale, Rieux et Tarrou feront de la peste la métaphore de toutes les atteintes à la dignité et à la liberté de l’homme (à commencer par la mort) ; mais le roman fait un choix et se contente de raconter la forme très particulière que revêt une épidémie, présentée au sens propre.
De 1944 à 1955, avec ou sans Camus, Barthes revendique pour un sens littéral ou une écriture blanche, afin d’échapper aux mensonges de l’idéologie (au sens négatif et marxiste du terme). Mais tout se complique quand on constate que ce sens littéral ou cette écriture blanche ne vont pas de soi, que leur existence est sujette à caution, y compris chez Barthes. En effet, ce choix esthétique n’exclut pas un usage de la métaphore qui renoue avec les Belles Lettres et remet en cause la fameuse littéralité, puisque toute figure instaure un glissement sémantique. On a souvent relevé l’abondance des métaphores dans la scène du meurtre qui conclut la première partie de L’Étranger[8]. De même, dans « Réflexion sur le style de L’Étranger », l’écriture critique de Barthes en 1944 apparaît comme très (trop ?) fleurie :
Un beau texte est comme une eau marine ; sa couleur vient du reflet de son fond sur sa surface, et c’est là qu’il faut se promener, et non dans le ciel ou dans les abîmes ; il faut bien admettre que les idées sont toujours plus haut ou plus bas que la ligne des mots, et cette térébrante oscillation est source de détresse ; mais la ligne des mots est belle. […] le style de L’Étranger a quelque chose de marin : c’est une sorte de substance neutre, mais un peu vertigineuse à force de monotonie, parfois traversée de fulgurations, mais surtout soumise à la présence sous-marine de sables immobiles qui enchaînent ce style et le colorent. (OCI, 75)
On est frappé par une sorte de contradiction entre la revendication d’une écriture blanche et le style très orné qui exprime ce souhait. Au fond, Barthes ne renoncera jamais longtemps à son goût pour la métaphore, pour peu, bien sûr, que chaque écrivain réussisse à s’approprier la figure. Il insistera tout particulièrement sur la métaphore « inorigénée[9] », qui abolit la différence entre le comparé et le comparant. L’article de 1954 en donne un bel exemple avec le soleil qui au sens littéral ajoute plusieurs significations métaphoriques : « C’est d’ailleurs cette ambiguïté entre le Soleil-Chaleur et le Soleil-Lucidité, qui fait de L’Étranger une tragédie. » (OC1, 481) Faut-il le rappeler ? Barthes multiplie dans son œuvre ces métaphores qui courent de texte en texte, comme le bois isomorphe, la nef Argo ou la spirale… Et, pour comble d’ironie, s’il commence par regretter la confusion entre politique et médecine, Barthes n’hésitera pas dans sa Leçon inaugurale au Collège de France à confondre la linguistique et la politique pour qualifier la langue de « fasciste » ! Quant à l’allégorie, pourtant condamnée dans la préface sur La Peste, elle est pleinement réhabilitée dans Le Grand Fichier : « 2 XII 79. Valeur d’une œuvre : cette œuvre doit être allégorique » (GF, 978)
Comment expliquer ces contradictions, ces tensions ? Au fond, on n’élude pas facilement la question posée dans Roland Barthes par Roland Barthes : « Qu’est-ce que ça veut dire ? » (OCIV, 724) On peut rêver d’une exemption du sens (comme dans L’Empire des signes), d’une polysémie généralisée (comme dans S/Z), on ne peut (ni Camus, ni Barthes) renoncer face au monde à poser des questions et à esquisser des réponses. Mais comment construire la signification quand on ne se tourne plus vers la Transcendance – ce qui est clairement le cas pour les deux écrivains ? Quand on ne croit pas en Dieu, la solution pour garantir le sens (à la fois comme signification et comme direction) passe par une philosophie de l’Histoire.
Le sens et l’Histoire#
La réflexion sur l’Histoire apparaît comme un autre aspect fondamental de la polémique à propos de La Peste. Le roman de Camus relève-t-il de la chronique ou de l’histoire ? Pour Barthes, la réponse est claire : le roman est une chronique, parce que le temps n’y est pas organisé. À partir de ce premier constat, Barthes et Camus s’opposent nettement ; quand le premier affirme une philosophie de l’Histoire, le second n’y croit pas. Comme on le sait, Camus qui est résolument anti-hégélien ne se laisse pas guider par une prétendue « Raison » qui se révèlerait dans le temps, de siècle en siècle. On se souvient de la célèbre phrase de L’Homme révolté : « La fin justifie les moyens ? Cela est possible. Mais qui justifiera la fin[10] ? » La formule est à double entente : non seulement, aucune fin (existât-elle !) ne pourrait justifier les moyens, mais plus encore rien ne permet de justifier la fin (sinon les moyens eux-mêmes). À l’inverse, Barthes dans sa réponse se réclame encore du « matérialisme historique ». L’expression est à la fois justifiée (il s’agit bien de lire le marxisme comme une pensée de la temporalité) et quelque peu déplacée (la formulation très philosophique correspond mal au marxisme vulgarisé de Barthes). Quoi qu’il en soit, les deux hommes s’opposent – et bien plus fortement que sur la littérarité et la métaphore – sur la transcendance historique.
Mais l’abîme entre les deux penseurs va rapidement se réduire, voire se combler. En effet, Barthes prend lui aussi ses distances avec Hegel. Un fragment de Roland Barthes par Roland Barthes (« Et si je n’avais pas lu…) manifeste une certaine désinvolture à l’égard des lectures obligatoires et des diktats de la modernité :
Et si je n’avais pas lu Hegel, ni La Princesse de Clèves, ni Les Chats de Lévi-Strauss, ni L’Anti-Œdipe ? – […]
(Répression : n’avoir pas lu Hegel serait une faute exorbitante pour un agrégé de philosophie, pour un intellectuel marxiste, pour un spécialiste de Bataille. Mais moi ? Où commencent mes devoirs de lecture ?) » (OCIV, 678)
Quelques années plus tard, en 1979, quand Barthes projette d’écrire « Notre littérature » (une histoire de la littérature dont les esquisses figurent dans le Fichier[11]), il se refuse à une organisation qui relèverait d’une téléologie et serait donc « hégélienne » :
Jubilation 15 juillet 79
Effleuré par une nouvelle idée d’œuvre en feuilletant pour le Cour le Castex et Surer, idée de me consacrer (changement complet de projet, investissement à fond) à une Histoire de la litt. française.
– Un Histoire ? Non : ce serait anti-hégélien. Plutôt une Histoire morcelée, par thèmes ? Une Histoire en miettes ? Histoire (naturelle, sauvage) de la litt. frç
Ces notes semi-rédigées, très elliptiques, appellent une explicitation. Le « ce serait anti-hégélien » désigne le but à atteindre (une nouvelle histoire) et non une allégeance à La Phénoménologie de l’Esprit. Autrement dit, le conditionnel manifeste une intention, non une réticence. Il s’agit bien pour Barthes de rêver une rupture avec la dialectique et la Aufhebung, au profit d’une temporalité en miettes ou en morceaux. Enfin, dans une page souvent commentée de son journal (reproduite dans « Délibération », 1979), Barthes prend du recul par rapport à la « modernité », comme philosophie de l’Histoire (OCV, 676) : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne. » Par cette affirmation inattendue, il ne se définit pas comme conservateur, réactionnaire ou antimoderne, mais il cesse de se référer à une pensée vectorisée du temps, de s’inscrire dans une chronologie organisée qui obligerait à faire des choix en conformité avec l’ordre des événements[12]. Si « Être moderne, c’est savoir ce qui n’est plus possible », comme on peut lire en 1973 dans « Réquichot et son corps » (OCIV, 397), désormais, tout est possible – ou du moins le choix ne dépend plus de la Raison dans l’Histoire.
Cette lente désaffection (que l’on retrouve également dans la lettre à Bernard-Henri Lévy[13] à propos des « nouveaux philosophes ») renvoie aux relations complexes que Barthes entretient avec le marxisme, dont il déplore la transformation en doxa et en stéréotypes comme on peut-on lire sur une fiche de 1979 :
Étant le plus emprunté des langages, le langage politique est à la fois le plus facile à parler et celui qui procure la plus forte saturation, et donc le plus tenace dégoût. Je ne peux plus, je ne peux plus, s’écriait-il devant la langue marxiste, comme un mari qui n’en peut plus de sa femme. Et de façon à se maîtriser tout de même, à empêcher que cette saturation ne se tourne en revirement violent et en une « scène » agressive, il s’efforcerait d’observer une sorte de discrétion politique – comme une discrète et amicable (sic) séparation de corps (FV)
Une autre fiche se montre plus lapidaire dans ses choix : « Je n’aime pas… Lénine/J’aime… Marx ». (FV) Mais l’éloignement se fait plus grand encore quand Barthes vire au scepticisme : « Êtes-vous marxiste ? – Oui, je suis marxiste, mais sans la foi[14]. » (FV)
Cet éloignement contribue à rapprocher Barthes et Camus. Une fiche en particulier instaure un dialogue inattendu. Il est à nouveau question de fascisme, cette fois-ci loin de toutes métaphores – même si le mot prend un sens politique très large :
La distinction de ce qui est fasciste (répressif) et de ce qui ne l’est pas vient souvent de la considération des causes, mobiles, fins, etc.
Mais : l’homme ne vit pas de causes, mais d’effets[15]. (FV)
On retrouve le vocabulaire critiqué dans L’Homme révolté (causes, mobiles, fins…), les débats propres à une époque qui distingue la bonne et la mauvaise violence, qui légitime la mise à mort par un discours téléologique. Or, comme Camus, Barthes en valorisant le mot « effets » rappelle utilement que l’être-là de la souffrance importe bien davantage que le cheminement intellectuel chargé de la justifier. À quinze ans d’intervalles, les deux hommes réagissent de façon semblable quand ils sont confrontés à la violence brute.
Attentif à l’actualité politique, le Grand fichier aborde à plusieurs reprises un sujet très présent dans l’œuvre de Camus : le terrorisme. Face aux attentats de l’ETA, Barthes trouve des accents très camusiens pour clamer son indignation :
30 VIII 79
Terrorisme basque en Espagne.
Trois bombes à Madrid (gares, aéroport), 5 morts, 90 blessés).
→ Fureur, indignation, impuissance de langage. Pour moi, c’est l’essence même du crime. » (GF 540)
24 nov 79
Terrorisme : on ne peut tout de même tuer des hommes (et tout le deuil pour ceux qui restent, toute la peine de ceux qui aiment), sur la simple foi d’un raisonnement abstrait, qui ne les concerne pas. » (GF 917)
« Terrorisme : un fusil au bout d’un raisonnement ! (GFII 7)
Du terrorisme de la Révolution russe (Les Justes) ou de la guerre d’Algérie (Le Premier Homme) au terrorisme qui frappe l’Espagne, c’est le même haut le cœur qui rétablit un dialogue indirect entre les deux hommes.
Le 2 septembre 1978, un entretien sur la violence pour la revue protestante Réforme exprimait déjà le respect absolu de la vie humaine :
Un problème aigu est posé par la violence lorsqu’elle se présente comme étant au service d’une cause, d’une idée. Pour ma part, je supporte très mal qu’un alibi doctrinal soit donné à des conduites de violence et de destruction. Je fais mien ce mot très simple d’un calviniste du XVIe siècle, Castellion : « Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. » Par là-même, Castillon s’est opposé à Calvin de Genève. Le bénéfice de cette phrase est de représenter, dirais-je, l’entêtement de la lettre, le moment où la lettre – tuer un homme – ne tue pas, mais garde la vie. Interpréter la lettre – dire que tuer un homme, c’est défendre une doctrine – me paraît indéfendable, face à la vie. » (OCV 551-552).
Le jugement de Castillon, un protestant s’adressant à un autre protestant, cité par Barthes, lui-même élevé dans le protestantisme, vaut pour l’humanité entière ; mais il s’adresse d’abord à une minorité religieuse, souvent persécutée. Le message est clair : rien ne peut justifier le meurtre, rien ne peut faire oublier le sens littéral de l’expression « Tuer un homme » – y compris quand l’assassin appartient au monde des persécutés et des victimes.
Quel humanisme ?#
Mais que peut-on fonder sur les « effets », sur les plaisirs ou les déplaisirs que procure la vie ? Quel humanisme peut-on dégager d’une souffrance ou d’un bonheur que chacun éprouve solitairement et sans esprit de suite ? Dans Mythologies, Barthes se méfie de la croyance en une humanité abstraite, en cette « grande famille des hommes » (OCI, 806) qui sert surtout à abolir les différences et les inégalités (de classes en particulier). Si la prise en compte des « effets » est nécessaire, mais pas suffisante, s’impose la recherche d’une pensée véritable, c’est-à-dire d’une pensée politique, qui évitera de céder au pur hédonisme et à la versatilité des affects. On relève une même goût chez les deux écrivains pour la « tendre indifférence du monde », pour toutes les sollicitations qui s’offrent au désir. Chez le jeune Barthes, des pages très sensuelles rappellent l’éloge de la Méditerranée écrit par Camus. En particulier, l’article « En Grèce », qui date lui aussi de 1944, se donne parfois à lire comme un quasi-pastiche de L’exil et le royaume et, dans un tel contexte, l’emploi du mot « noces[16] » n’a rien d’anodin… Mais, pour l’un et l’autre écrivains, une « pathologie[17] » (au sens barthésien) sans éthique, ne peut se suffire à elle-même.
En effet, l’homme émotif perd facilement le sens de la mesure, comme l’amoureux qui, oubliant le sens des proportions, met sur le même plan sa douleur personnelle et les horreurs de l’histoire :
La catastrophe amoureuse est peut-être proche de ce qu’on a appelé, dans le champ psychotique, une situation extrême, qui est « une situation vécue par le sujet comme devant irrémédiablement le détruire » ; l’image en est tirée de ce qui s’est passé à Dachau. N’est-il pas indécent de comparer la situation d’un sujet en mal d’amour à celle d’un concentrationnaire de Dachau ? L’une des injures les plus inimaginables de l’Histoire peut-elle se retrouver dans un incident futile, enfantin, sophistiqué, obscur, advenu à un sujet confortable, qui est seulement la proie de son Imaginaire ? » (FDA, « La catastrophe, OCV, 79, 80)
Pour dépasser l’égoïsme de l’amoureux, mais sans renoncer aux affects, comment donner une dimension morale au pathos, comment inscrire nos émotions dans le cadre de la solidarité – cette solidarité que Barthes reconnaissait bien volontiers aux personnages de La Peste ?
Qu’il s’agisse de la compassion en général, de la charité chrétienne, du mitleid parsifalien, la pitié, en rapprochant les hommes par le partage d’une même souffrance, campe – et campe seulement – au seuil d’une action authentiquement politique. Dans La Chambre claire, Barthes analyse l’émotion qui l’étreint devant certaines photos. Mais cette émotion reste strictement individuelle malgré la comparaison avec Nietzsche :
Dans l’amour soulevé par la Photographie (par certaines photos), une autre musique se faisait entendre, au nom bizarrement démodé : la Pitié. Je rassemblais dans une dernière pensée les images qui m’avaient « point » (puisque telle est l’action du punctum), comme celle de la négresse au mince collier, aux souliers à brides. À travers chacune d’elles, infailliblement, je passais outre l’irréalité de la chose représentée, j’entrais follement dans le spectacle, dans l’image, entourant de mes bras ce qui est mort, ce qui va mourir, comme le fit Nietzsche, lorsque, le 3 janvier 1889, il se jeta en pleurant au cou d’un cheval martyrisé : devenu fou pour cause de Pitié. (OCV, 883)
Le Grand Fichier propose de nombreuses notations qui vont dans le même sens, construisant une communauté réunie par une douleur partagée. L’emprisonnement de Hoveyda, le premier ministre du Shah, suscite chez Barthes une compassion qu’on n’attendait pas forcément et dont on devine le caractère projectif (présence de la mère aimante) :
Âgé, a perdu 62 kg. Réveillé en pleine nuit ds sa prison, est amené au tribunal. Il avait pris un somnifère, n’ayant pas été prévenu : regard inquiet, éperdu, et transpirant.
-… « J’ai aussi une vielle mère qui est très pieuse ».
*-… Bien que premier ministre, je menai une vie simple. J’ai une mère de 80 ans et je l’aime beaucoup…
Je n’ai pas voulu que ma mère me rende visite ici, parce que je ne voulais pas qu’elle me voie dans cet état. Il vaut mieux qu’elle se contente des doux souvenirs du passé. (GF 378)
D’une manière plus explicite encore, une fiche témoigne du sentiment très fort que fait naître Gracia, la belle-soeur de Michel Salzedo[18] :
22 Juil 79
L’amour du monde, la Pitié
Par ex.
Combien me faisait mal la gentillesse, l’absence de méchanceté, la vulnérabilité de Gracia, la sœur, de Rachel, repartant auj. pour Israël, affolée par le voyage, impatiente de retrouver les siens, son chez soi – minuscule âme innocente, enjeu d’une tempête mondiale (je retrouverais sans doute la même pitié du côté de quelque femme palestinienne). (GF 513)
La pitié suffit sans doute pour esquisser un premier rapprochement et fonder un système de valeurs, mais elle tourne rapidement court. Notre humanité est concernée par Hoveyda, par Gracia, par toutes les femmes innocentes ; mais on ne doit pas oublier non plus les crimes du Shah dont Hoveyda était l’artisan, le conflit israélo-palestinien, qui ne se résoudra pas seulement en comptant les victimes et en se situant au-dessus de la mêlée. Très conscient des insuffisances de l’affect qui surgit tout d’un coup pour retomber comme un soufflé, Barthes raconte une scénette vécue dans le jardin du Luxembourg :
Pendant une seconde, une petite fille a perdu ses parents : crise de larmes, ravage, révulsion ; c’est l’abandon pur donnant l’idée d’un tréfonds du corps, de l’âme. J’en suis bouleversé de pitié.
Elle retrouve son père, continue à geindre mais en râlant. (GF 808)
Pire encore, la pitié ne se verbalise pas et se montre incapable d’engendrer un discours, littéraire ou politique, manifestant un véritable engagement dans la société :
27 XI 79
Problème de l’insertion de la Pitié. Peut-être qques incidents de « Pitié » (ex 14 VIII) comme des ponctuations, des scansions – sans commentaire :
La Pitié, ça ne se dit pas.
Pas de Méta-Pitié (GF 935)
On ne misera pas davantage sur la « sympathie » des corps, dont Barthes ressent la nostalgie en opposant la foule du Front populaire aux mouvements politiques contemporains :
Le désir (fou-maîtrisé) de retrouver la possibilité d’un goût, d’une satisfaction corporelle à la Révolution, d’une sympathie.
C’est le complexe Front Populaire (importance dans sa vie bien que politiquement, peu défendable) – relancé par Brecht – Ce qui manque actuellement tant : il n’y a plus de corporel populaire : rien que des petits bourgeois. D’où mon goût plus facile pour les causes révoluti. étrangères, où il y a du vrai peuple (et non un personnel promotionnel). (FV)
Pour tentante qu’elle soit, la communion des cœurs et des corps n’est plus d’actualité : elle appartient à un autre monde ou elle échoue systématiquement à prendre forme.
Pour transcender la pitié, pour structurer les affects, la meilleure des réponses correspond finalement à une réaffirmation, voire à une réhabilitation, de l’idéal démocratique, de cette démocratie représentative, dite « bourgeoise », que dénonçait souvent la classe intellectuelle sensible aux sirènes de la Révolution[19]. Assumant pleinement son statut de « démodé « (c’est-à-dire en fait de minoritaire), Barthes affirme dans les années 70 le désir de faire du contrat la source et le cadre de toute communauté : « Je vis continument dans le démodé. Quand je suis amoureux – le fait même de l’être, je suis démodé. Quand j’aime ma mère, je suis démodé. Quand je suis démocrate, je suis démodé… etc. » (GF ?) La défense ne consiste plus à rénover la démocratie en l’arrachant aux mensonges de la bourgeoisie, mais à assumer, non sans provocation, sa propre « bourgeoisité » dans un milieu intellectuel très hostile à la classe dont il est généralement issu. Ainsi de la fiche « Bourgeois » :
Je tiens toute mon œuvre d’une certaine spécificité bourgeoise – donc, bien la décrire, dans sa particularité (par rapport à la grande bourgeoisie)
- Cette origine se trouve :
- Veine progressiste. Esprit critique (de démystification)
- Hostilité au petit-bourgeois
- Goût de la Culture (la litt)
- Esprit Démocratique etc.[20] (FV)
Ainsi encore de cette affirmation intempestive, si provocante que Barthes ne l’aurait sans doute pas publiée : « J’ai dit : je suis bourgeois comme d’autres : je suis juif. » (FV)
Après l’admiration des années 40, la querelle des années 50, le Barthes des années 70 renoue incontestablement avec Camus, par une même réticence à l’égard du sang versé et par la quête d’un humanisme tournant le dos à tous les totalitarismes, y compris les mieux intentionnés. Une fiche, toujours tirée du Grand Fichier, montre bien qu’un tel rapprochement n’est pas simplement le fruit d’un commentaire extérieur. Barthes réfléchit à Vita Nova, ce roman qu’il souhaite écrire :
Roman
Au cours d’un dîner d’intellectuels, un personnage expose – dans l’incompréhension et la désapprobation générale – une théorie de l’époché politique (tempérée cependant), et d’un mode d’engagement purement moral (éthique) déterminée par l’obligation de réparer toute injure du pouvoir
Mais c’est du Alain, du Camus : très « petit bourgeois (GF 86)
Certes, la dernière remarque, ajoutée verticalement en marge, manifeste un recul ironique par rapport à cet humanisme « démodé » qui anime le désir de roman. Mais comme souvent chez Barthes, l’ironie en imposant une distance pleine d’incertitude sert aussi à rendre acceptable une affirmation qui entre en opposition franche avec la doxa de l’époque. Glosons un peu l’ironie de la fiche : bien sûr, l’humanisme camusien est récupéré par la petite-bourgeoisie, la fraternité généralisée frôle souvent la morale niaiseuse du boy-scout. Mais, en même temps, grâce aux vertus de la spirale (métaphore chère à Barthes) qui reprend, déplace et élève, le refus de « toute injure du pouvoir » correspond parfaitement à la volonté barthésienne de penser la politique autrement, à partir des « effets » ou des « moyens » et non plus des principes.
Cette connivence des deux écrivains triomphe enfin dans une même fascination pour le style – qui inscrit cette fois-ci dans la littérature la difficile relation de l’individu et du groupe. Il existe au moins deux approches du style chez Barthes. La première, la plus connue, correspond au Degré zéro de l’écriture, qui associe le style à la singularité créatrice, dans le sillage d’un romantisme rénové par la physiologie. La seconde est plus ancienne, formulée par Aristote et sans cesse reprise y compris dans la France des XIXe et XXe siècles : le style correspond à un niveau de langue et d’expression, c’est-à-dire à un code qui transcende toute individualité. De telles considérations nous ramènent au début de la relation entre Barthes et Camus. Quand il admire L’Étranger, Barthes souligne le classicisme de l’écriture, la présence d’un style défini comme exigence esthétique et langue commune. Au fond, Camus, en inventant l’écriture blanche, sans rompre avec l’héritage culturel, réussit le difficile équilibre entre l’insertion dans une tradition et son renouvellement, entre la rhétorique et la poétique, entre le code et l’individualisme, réalisant le rêve d’une idiorrythmie[21] littéraire capable de faire tenir ensemble l’aspiration à la solitude et le souci de la société[22].
Une dernière fiche extraite du Grand Fichier servira de conclusion : « Lettre de Rivière[23] : je suis un moraliste matérialiste./Oui, c’est vrai : et c’est la chose qui crève les yeux et que personne n’a dite : cad que c’est la lettre volée ». (FV) Barthes, en moraliste matérialiste ? Bien sûr ; mais le constat vaut tout autant pour Camus. Au-delà de leurs différences, voire de leurs importantes divergences, les deux hommes, intellectuels, et écrivains partagent le même désir de trouver au cœur de l’immanence un humanisme pour aujourd’hui.
Notes#
- Voir de Roland Barthes, Comment vivre ensemble Cours et séminaire au Collège de France (1976-1977), texte établi, annoté et présenté par Claude Coste, Paris, Seuil-Imec, « travaux écrites », 2002, p. 48. ↑
- Les références sont données dans l’édition des Œuvres complètes en 5 tomes (abrégée OC, suivi de la tomaison et du numéro de page), procurée par Éric Marty (Paris, Seuil, 2002). ↑
- Moins connue est la vive réaction de Camus à la lecture du numéro de Théâtre populaire consacré à Brecht et largement conçu par Barthes : « Le numéro sur Brecht m’a achevé. On ne peut mieux démontrer l’ignorance de toute expression théâtrale, le néant de toute cette tentation. La vérité est que dans la haine où vous êtes de la société présente, vous voulez supprimer tout motif de réconciliation même positif. D’où votre haine de l’émotion. Mais l’émotion théâtrale ne réunit pas le spectateur à cette société. Elle le réunit à tous les hommes. Elle préfigure cette société dont vous rêvez qui n’est possible pour le moment que dans l’instant. La distanciation ne revient qu’à détruire toute tradition, toute universalité pour faire du spectateur un esprit ennemi. Quant à la scène, elle y fait disparaître grandeur et vérité humaine, pour y faire régner le pédagogue, le didactisme, l’enseignement du dogme, qui est le contraire de la vérité. Le dogme lui-même est d’ailleurs négatif. » Albert Camus, « Sur le théâtre » (1955), Œuvres complètes, III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 1128. ↑
- Roland Barthes, « La Peste, annales d’une épidémie ou roman de la solitude ? (avec une lettre de Camus à Roland Barthes) – Club, février 1955, « Réponse de Roland Barthes à Albert Camus », Club, avril 1955. Ces deux textes sont recueillis dans le premier tome des Œuvres complètes, op. cit. ↑
- Depuis les années 50, Barthes tient un monumental fichier qui prend, de plus en plus l’allure d’un journal intime à la fin des années 70. Je remercie chaleureusement Amina et Michel Salzedo, Éric Marty, pour m’avoir autorisé à consulter et citer ces archives. Les fiches citées dans cet article appartiennent au Grand fichier (abrégé : GF) conservé à la BnF : NAF 28630 (51) et NAF 28630 (52) et au Fichier vert (abrégé FV), lui aussi conservé à la BnF : NAF 28630 (47), NAF 28630 (48) et NAF 28630 (49) ↑
- « Réponse de Roland Barthes à Albert Camus », paru dans Club, avril 1955, ibid., p. 573. ↑
- « La Peste, dont j’ai voulu qu’elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n’est pas nommé, tout le monde l’a reconnu, et dans tous les pays d’Europe. » « Lettre d’Albert Camus à Roland Barthes sur « La Peste » » (OCI, 546). ↑
- « Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. » Albert Camus, L’Étranger, Paris, Gallimard [1942], « folio », 1975, p. 95. ↑
- « J’appelle métaphore inorigénée une chaîne de substitution dans laquelle on s’abstient de repérer un terme premier, fondateur. La langue elle-même, parfois, produit des comparaisons, sinon inorigénées, du moins inversées : l’amadou est une substance qui s’enflamme facilement : il tire son nom (provençal) de l’amoureux qui s’enflamme : c’est le « sentimental » qui permet de nommer le « matériel ». Roland Barthes, « Digressions », OCIII, 994. ↑
- Albert Camus, L’Homme révolté, Paris, Gallimard [1951], « Folio essais », 2016, p. 365. ↑
- Fichier « Notre littérature » (NAF 26830). Sur ce projet, voir de Claude Coste « « Notre littérature » : genèse d’un projet de Roland Barthes », Genesis, 52, 2021. ↑
- Déjà dans « Le style de L’Étranger » et dans « L’Étranger roman solaire », Barthes se montrait sensible à un univers sans causalité. ↑
- « Certes, j’ai eu un rapport très personnel aux idées que vous énoncez : la plupart, vous le savez, me sont trop proches (en gros, celles qui ont trait à la crise de la transcendance historique), d’autres plus distantes (votre critique de Deleuze me paraît erronée). » Roland Barthes, « Lettre à Bernard-Henri Lévy », OCV, 314. ↑
- « Pendant longtemps, l’ennemi à apaiser, c’était le Sur Moi marxiste. » (GF, 51) Ce sur-moi marxiste empêche sans doute Barthes de faire une place à L’Homme révolté, cet essai qu’une partie de la gauche intellectuelle n’a pas voulu lire, sinon pour en montrer les omissions réelles (en particulier, sur la question coloniale, comme l’a bien montré Yves Ansel dans Albert Camus, totem et tabou. Politique de la postérité, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2012).↑
- On pense à la définition très concrète du mal donnée par Voltaire dans Candide à la fin de l’épisode célèbre du Nègre de Surinam : « O Pangloss !, s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomination ; c’en est fait ! Il faudra qu’à la fin je renonce à ton Optimisme. – Qu’est-ce qu’Optimisme ?, disait Cacambo. – Hélas, dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal ! » ↑
- « Cette succession ordonnée de lumières et d’horizons plus solides me symbolise les noces de la terre et de l’eau, nulle part plus somptueuses qu’ici ; l’île est le centre d’un embrasement solaire ; le soleil insiste, il épaissit le sang ; il entre par les yeux, par les oreilles, on l’entend, c’est un silence térébrant ; puis il dilue, allège, aspire ; il attache à chaque vague une épée de flammes. » Roland Barthes, « En Grèce », OCI, 73. ↑
- Dans une perspective phénoménologique, le pathos désigne chez Barthes à la fois le monde en tant qu’il affecte le sujet et le sujet en tant qu’il est affecté par le monde. Voir en particulier La Préparation du roman (édition de Nathalie Léger, Paris, Seuil, 2003). ↑
- Gracia est la sœur de Rachel, la première femme de Michel Salzedo, le demi-frère de Barthes. ↑
- « La Démocratie : c’est un mot saturé de désillusions, jusqu’au dégoût, parfois jusqu’à la violence ; les leurres de la démocratie bourgeoise ont été abondamment démystifiés. Peut-être ne faut-il pas, cependant, jeter l’enfant avec l’eau de la baignoire. J’aimerais une théorie des « couches d’acquis » de l’Histoire : la bourgeoisie, c’est comme de la terre, c’est fait de plusieurs couches, les unes bonnes, les autres mauvaises ; il faut trier, établir une géologie différentielle. Et puis, on peut avoir de la Démocratie une idée difficile : la définir non comme la réalisation d’une grégarité étouffante, mais comme « ce qui devrait produire des âmes aristocratiques » (dit un commentateur de Spinoza) »., Roland Barthes, « L’image », OCV, 515-516 ↑
- À propos des traits de bourgeoisie dans sa vie et dans son œuvre, Barthes conclut amèrement : « Tout ce qui me ferait repérer, en période de révolutions, de terreur, etc. » (GF ?) ↑
- Dans Comment vivre ensemble, op. cit., Barthes emprunte le terme d’idiorrythmie à Jacques Lacarrière (L’Été grec). Appartenant au vocabulaire religieux, le mot désigne la vie de moines vivant en marge du monastère auquel ils sont rattachés, conciliant érémitisme et cénobitisme. ↑
- « Le plaisir du style, même dans les œuvres d’avant-garde, ne s’obtiendra jamais que par fidélité à certaines préoccupations classiques qui sont l’harmonie, la correction, la simplicité, la beauté, etc., bref les éléments séculaires du goût. Ces conventions ont été respectées – mieux, asservies – par Camus, bien que le style de son livre repose sur une donnée contradictoire : ce livre respire l’absurde, le « Tout est égal », et ce livre est pourtant une œuvre d’art, c’est-à-dire qu’il se soumet à des procédés vieux comme Lucrèce, et que son écriture ne rompt pas avec les habitudes et les buts d’une littérature intelligente, c’est-à-dire dirigée ; le souci de plaire au public (qui est depuis la préface de Bérénice le grand principe classique), le concert des procédés rhétoriques, tout ce travail plein d’espoir est à première vue en contradiction avec l’absurde. (« Réflexion sur le style de L’Étranger », OCI, 75, 76) ↑
- Il s’agit de Jean-Loup Rivière, étudiant et ami de Barthes, dont il recueillera l’ensemble des Écrits sur le théâtre (Paris, Seuil, « Essais », 2002). Le projet entamé du vivant de Barthes ne verra le jour qu’une vingtaine d’années plus tard. ↑