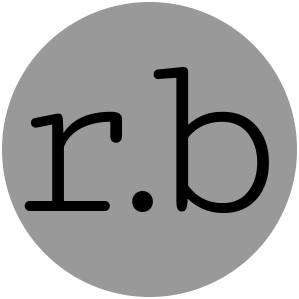ndlr : M. Fosse a rédigé le premier mémoire universitaire consacré à l’œuvre de Roland Barthes. Ce témoignage raconte l’aventure de cette recherche et les liens qui étaient les siens avec Barthes. On peut lire ici ce mémoire : mémoire_PV_FOSSE
Monsieur Bonnefis, mon patron de Mémoire comme on disait en 1970, m’avait reproché ce qu’il appelait mon « manque du côté de l’entrée », drôle d’expression pour dire que je n’arrivais jamais à commencer « une fois pour toutes et tant pis ou tant mieux » un rédactionnel, tellement, ayant lu Barthes, le flot d’images (5000 !) qui valaient en soi mais qui valaient surtout dans leur perpétuel renvoi entre elles, m’affolait.
Bien sûr, quelques thèmes directeurs s’imposaient, regroupant des items justifiables, mais comment oser imposer une organisation plus qu’une autre, « recelant tant d’entrées », pour reprendre le mot de M. Bonnefis, dans tant de textes pluriels ? Les diagrammes furent une solution (échappatoire ?), parce que superposables par glissements décalés, mais …
55 ans plus tard, rien n’a changé. Car, outre mon Mémoire, j’ai retrouvé une épaisse chemise cartonnée chargée de feuilles grand format, noircies de ma petite écriture et qui m’ont à nouveau étourdi à leur lecture disparate où il m’est devenu aujourd’hui impossible de faire la part entre mes notes préparatoires à mon travail définitif de celles de réflexions extérieures parfois référencées parfois non ou de propos de Barthes lui-même soit indirectement soit suite à des questions que je lui posais en cours d’année soit même lors d’une interview plus officielle qu’il m’avait accordée début 1971, datable, certes, mais tout autant débordant d’annotations personnelles ou non. Pas de trace en revanche et apparemment de mes notes prises lors de son Séminaire de 1972 auquel j’ai assisté (groupe 2 à 15h le jeudi à l’EPHE, début novembre (annexe 1) – thème proposé (?) « la modernité » -), ce qui me rend amer et furieux !
Comment savoir alors, si je veux rester honnête intellectuellement, qui parle ? Comment savoir, n’ayant quasiment rien lu des travaux sur son œuvre, si ce que je vais écrire aujourd’hui n’a pas déjà été dit et analysé et n’est pas attribuable à quelqu’un d’autre que celui auquel je me réfère ? « Qui dit cela ? Sarrasine ? Le narrateur ? Balzac ? La sagesse universelle ? La psychologie romantique ? » (RB in Masculin, Féminin, Neutre – 1969-1970).
D’autant que se pose une nécessaire précaution à prendre quant à l’oxymore ou du moins le paradoxe qu’offre le syntagme quasi figé qu’est le « témoignage personnel » judicieusement suggéré par M. Claude Coste et généreusement accepté par M. Mathieu Messager, en accompagnement de l’édition en ligne de mon Mémoire de 1970-1971. Car le « témoignage », s’il n’est pas une « preuve … expose des éléments tangibles et vérifiables … servant à l’établissement de la vérité » (Le Robert), permettant de livrer à un hypothétique lecteur une information objective et peut-être exploitable par lui ; tandis que le « personnel » risque, de par sa subjectivité, de n’intéresser personne, même si possiblement révélateur de pans de personnalité de Barthes que d’aucuns prétendront avoir justement décryptés (Le dictionnaire RB – 2024 -, par exemple), mais certainement pas sous cette forme de proximité physique unique en quelque sorte.
Sans parler du propre de l’opinion qui n’est que « l’expression d’un équilibre instable et momentané » (PV Fosse – Cours EDHEC – 1973), qui n’a donc aucune valeur et du propre de l’information qui est d’être, par essence, déformée dès que formulée, a fortiori quand on parle de souvenirs, surtout si lointains, même si pour certains, l’impact d’un tel homme sur un petit étudiant était tel que leur passé demeure gravé au présent dans leur intégralité et intégrité.
Je, donc. Qui, l’épaisse thèse de J.P Richard sous le bras et ayant étudié Mallarmé en Certificat de Licence à Lille, sous l’autorité de M. Bonnefis et surtout ayant, entre autres ouvrages, lu avec avidité et passion Le degré zéro de l’écriture (1953), Mythologies (1957), jusqu’en toute fin le merveilleux Empire des signes (1970), qui correspondaient tant à ses aspirations « tout petit déjà » (Coluche) en linguistique (autre Certificat de Licence) et sémiologie, s’est tout naturellement tourné vers le Maître incontesté de ces disciplines nouvelles à l’époque, soutenu par ce professeur qui a accepté d’emblée d’être le Patron du Mémoire envisagé.
Hélas et déception pour l’hypothétique lecteur curieux de tout ce qui a émané du Maître, impossible de me souvenir du comment M. Bonnefis a réussi à me faire rencontrer Barthes. Se connaissaient-ils ? Est-ce par simple courrier que l’autorisation de travailler ses œuvres a été demandée ? Suis-je allé directement à l’EPHE le voir ? Le trou noir. Mais ce qui est certain, c’est que tout s’est déroulé de façon toute fluide, comme marquée du sceau de l’évidence, grâce à l’entregent de M. Bonnefis, bien sûr, mais surtout grâce à l’extraordinaire simplicité, marque des véritables grands, avec laquelle Barthes a accepté projet et étudiant.
Pourtant, dès les premiers échanges et à ma grande honte dont le souvenir me fait encore sincèrement rougir et alors que j’exposai la démarche que je voulais suivre, j’ai été amené à ponctuer mon propos de « discours barthien » en veux-tu en voilà, puisque, oralement, les morphèmes « e » et « s », désinences de son nom, disparaissaient à leur prononciation, à la différence par exemple – et je me souviens très bien de la comparaison que je faisais – du tennisman François Barthès dont l’accent grave sur le « e » final obligeait à le dire. Cette différence me semblait logique …
Petite cause, grands effets à court et long terme. Car très vite et avec sa délicatesse coutumière – et cette voix inoubliable -, Barthes me dit dans un petit sourire si fréquent chez lui sous cette forme-là esquissée : « barthésien, M. Fosse, barthésien ; ne m’enlevez pas le « e » de mon nom, seul élément de ma féminité ! ».
Ce fut un choc et une révélation. Traumatisme infamant, sentiment d’indignité. Mais tout en étant interloqué de cette répartie si spontanée et si tranquille, je me souviens également très bien que, tout épiderme dehors, j’ai senti et su d’emblée que quelque chose d’essentiel venait de se révéler, à savoir que cette voyelle manquante, la lettre la plus féminine de la langue française, portait en elle un poids affectif chez lui, tel un signe hautement significatif d’un « manque » (PV Fosse – 2025) antérieur incontournable.
D’ailleurs et pour double preuve, dans son interview par l’Express de mai 70,
– non seulement il insiste sur ce point « je suis habitué à ce qu’on fasse tomber ce « s » de la fin de mon nom dans une trappe. Or vous savez – affirmation qui appelle à une généralisation, principe d’un besoin de sécurisation – très bien que toucher à un nom propre, c’est quelque chose de grave : c’est porter atteinte à la propriété (ce qui m’indiffère) mais aussi à l’intégrité, ce à quoi, je suppose – quel luxe de précaution ! – personne – confirmation de la généralisation – n’est insensible, surtout lorsqu’on vient de lire une histoire de castration »,
– mais encore omet-il soigneusement de parler du « e » qui « tombe » avec le « s », oubli (inconscient – ? -) révélateur par essence.
Et pour cause. M. Massin, dont j’ai lu récemment l’analyse qu’il fait de cette « castration », souligne à bon escient la signification de cette douleur existentielle chez Barthes, mais sans la conclusion qui s’impose d’évidence (« … phallus atrophié qui n’a jamais pu rejoindre la courbe, s’unir à elle … ») quant à l’origine et la nature de cette union incestueuse à la mère. Certes, d’aucuns en ont parlé, décryptant culturellement avec talent et références ce FAIT, mais jamais avec cette approche personnelle entre nous et qui lui a fait dire un jour où je lui disais ne pas être digne, par manques multiples en sémiologie par rapport à lui, de ce qu’il m’offrait en un inestimable cadeau (signer à sa place sa bibliographie au Seuil – cf. plus loin -) : « et pourtant, m’a-t-il dit,– c’est ce « et pourtant » qui m’avait frappé – je sais que vous savez ma faille et je ne sais pas la vôtre » … Bel hommage gravé à jamais en moi et qui m’a porté toute ma vie de travail en ce domaine sémiologique sous l’angle psychanalytique, me crédibilisant avec fierté en mon for intérieur où j’entendais sa voix …
Mais revenons au Mémoire proprement dit et par ordre chronologique, à l’interview qu’il m’a accordée le 27 janvier 71. Bien sûr, lors de toute la fin d’année 70 post rentrée, j’avais eu l’occasion d’échanger ponctuellement avec lui, à partir de discussions que j’avais avec M. Bonnefis quant à l’orientation à donner à mon travail, mais ce tête à-tête sérieux était le premier. Et le plus simple et le mieux est d’ouvrir les parenthèses pour le laisser parler de ce qu’il entrevoyait pour moi, d’autant que c’est ce qu’attendent d’hypothétiques lecteurs de ce témoignage. En reprécisant par honnêteté que je pars des notes prises certes ce jour-là mais notes agrémentées de réflexions et compléments d’informations venues de plusieurs sources et donc qui risquent d’avoir été prises dans d’autres œuvres de Barthes. En conséquence, l’ensemble de ses verbatims n’a peut-être pas été énoncé ce 27 janvier, mais l’essentiel est là et scrupuleusement retranscrit. En vrac :
« la thématique n’a aucun intérêt dans ce travail » (ça partait bien, pour moi!!!) ; « l’idée de montage est une idée attrayante mais qui représente un énorme travail de patience » ; « l’intérêt dans ce « mémoire » serait de définir des bouts de phrases, des en-coins (sic) de mots » ;
« il n’y a pas de métaphore véritable. Il y en a chez les Romantiques (ex : Chateaubriand) » ; « conseil : essayez de repérer les phrases, les connotations et les ambiguïtés » (diantre !!) ;
« le problème intéressant serait de subvertir la forme du Commentaire. C’est ce que j’ai fait dans Sarrasine» (notons qu’il me demande de souligner le verbe « subvertir », façon d’y insister) ;
selon lui, il y aurait « deux possibilités pour bâtir ce Mémoire : après collection des citations (??), tout se joue selon deux procédés : soit faire une organisation thématique (se contredit-il eu égard à sa première remarque?) qui se répète ou se substitue avec une finalité existentielle (type JP Richard) ou plus spiritualiste (type Poulet) ou psychanalytique (type Mauron), soit un montage qui doit être fait avec une certaine élégance des articulations » ;
« les veinules du sens ? Ça n’a pas de sens métaphorique. La vraie image, le message fort en est l’idée de réseau au sens structuraliste, leibnitzien du terme, avec ramifications de plus en plus subtiles. Cela reste sur un plan combinatoire » ;
« cet exposé (!!) a un double intérêt : il induit à (?) toute une référence structuraliste du réseau qui induit la micro-analyse. Mais de plus, il rend présent le corps ; il y a la pression du champ symbolique du corps humain » ;
« le corps et la nutrition sont importants pour moi. S’il y a une unité du champ des composants, c’est là qu’il faut la chercher » ;
« le problème de la déchirure ? C’est une époque derridéenne ou pré-derridéenne » ; Comment vous situez-vous par rapport à Derrida, Kristeva, etc … ? « Je me situe toujours par rapport à des langages mais non par rapport à des écrivains » ;
« Derrida m’a incontestablement apporté un certain afflux de métaphores très particulières presque philosophiques » ;
« la vraie méthode serait de comparer avec un texte autre que moi (fabuleuse, cette appropriation personnalisée qui entraîne cette « faute » – apparente – qui lui fait dire « moi » au lieu de « le ou les miens » : il EST bien ses textes, il n’y a QUE son corps qui parle, écrit, son « esprit » n’est que soutien postérieur à ce corps et non antérieur : le corps est bien premier ET prioritaire, d’où son dilemme avec « l’événement en surface » comme il disait et la notion de « profondeur, un mythe de Droite »), c’est-à-dire par exemple un texte sociologique, un texte d’écrivants (cette dichotomie écrivain/écrivant lui tenait vraiment à cœur – combien de fois ne me l’a-t-il pas répété ! -, tout comme la distinction métaphore/métonymie, qui n’allait pas de soi pour lui – je voulais en faire un petit essai avec son aide !!! Prétentieux ou naïf que j’étais !! -) et voir si l’on trouve (!!??) des métaphores. Je ne les refuse pas, cela tient au langage » ; « en réalité, ou rendre compte par les ambiguïtés, les classes (mots dénotés et métaphoriques : leur présence veut dire qu’on assume le champ symbolique au sens psychanalytique du terme). Ou considérer qu’il existe une conduite castratrice qui explique que l’on assume des images combattant cela (ex : présence du corps) » ;
« conclusion : expliquer l’ambiguïté de la situation par rapport au champ intellectuel dépassant le cadre sociologique » ;
« l’utilisation de termes scientifiques par exemple tient à l’existence de périodes : par exemple période de désir scientifique qui m’a traversé à une certaine époque » ;
« psychanalyse : langage de culture » ;
« toutes les métaphores viennent du corps » ;
« résumé :
– le corps
– le sens de l’ambiguïté : maintenir un champ symbolique dans un discours
– « présence du projet structuraliste dans la métaphore. »
Voilà repris mot à mot autant que possible le bilan de cette interview du mercredi 27 janvier 71. En espérant que ces verbatims (certains devenus incompréhensibles pour moi) puissent servir et aider quelque lecteur essayiste aventureux …
Un autre moment fort de cette première moitié d’année 71 a été sans conteste le rendez-vous que Barthes m’avait fixé le 5 juin, un samedi soir (!!) chez lui dans son appartement, confirmé par M. Coste dans un mail que celui-ci m’a gentiment envoyé le 31 mai de cette année 2025 : « cher monsieur, j’ai passé ma semaine à la BnF à consulter les agendas de Barthes. Voici ce que je lis à la date du 5 juin 1971 : « visite Fosse ». Bien cordialement, Claude Coste. »
Ouf ! C’était donc bien une réalité. Parce que le rendez-vous en question, qui a été d’ailleurs reporté par lui (annexe 2 et 2 bis) m’en a laissé un souvenir étrange. Je me souviens avoir été reçu par le Maître en djellaba marocaine – curieuse tenue pour une rencontre de travail, me suis-je dit alors naïvement, sans aller plus loin dans l’interprétation, en live – ; lui avoir demandé, après échanges sans doute professionnels (je ne me souviens plus. En tous cas, rien de personnel ni sur lui ni sur moi, à moins que le fait d’avoir parlé musique, lui, de Schumann, moi de Liszt, étant tous deux de fervents musiciens et musicologues, soit considéré comme personnel), de me jouer un morceau au petit piano pour débutant qui se trouvait là, posé contre un mur (ce n’était ni un Steinway ni un Pleyel !), ce qu’il m’a refusé, prétextant qu’il ne jouait jamais devant quelqu’un (d’étranger?), ce qui m’a beaucoup déçu a posteriori quand, à peine quelques jours (ou semaines?) plus tard – je me souviens de la coïncidence qui m’a frappé – j’ai vu à la TV un reportage sur lui (il doit être facile d’en retrouver la date et la chaîne) qui ouvrait sur lui … au piano !!! – souvenir d’un sentiment puéril de trahison – ; et enfin et surtout, avoir reçu de ses mains en cadeau un petit livret à tirage limité Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss (1970), son ami, dont le texte, sans hasard, traitait du Masculin, Féminin, Neutre (1969-1970)(annexe 3).
Voilà qui ne va pas intéresser grandement un hypothétique lecteur avide d’informations sur lui, mais je tenais à en signaler l’existence et ses modalités de contenu, parce que, ajoutées à d’autres à venir, celles-ci ne manquent pas de me troubler aujourd’hui quant à la nature réelle des rapports qu’il avait avec moi.
Ainsi, l’épisode un rien épique courant l’été 71, concernant son désir de me voir prendre en mains sa bibliographie que lui réclamait le Seuil (Tel Quel). Etant personnellement parti 50 jours faire le tour de la Méditerranée en 2CV (+ de 13000 kms), s’en est ensuivi un imbroglio d’envois de courriers dont je n’ai retrouvé, hélas, qu’une faible partie. Maintenant que j’en parle, d’ailleurs, je pense que le soir du 5 juin avait été le prétexte à la mise au point des modalités de la construction de cette bibliographie. Mais mieux que tout discours, ses lettres reçues parleront d’elles-mêmes et démontreront à l’envi combien cet homme était d’une douce et délicate générosité (annexes 4 et 4 bis, 5 et 5 bis, 6). Mais le plus incroyable est qu’il ait pensé ce projet pour moi et, après cette issue malheureuse et inévitable, comme il le dit lui-même, d’avoir voulu (espéré ?) « un autre projet », « une publication ultérieure » avec moi. Et même sans lui, si je puis dire, puisque maintes et maintes fois, il m’a poussé à écrire afin que je sois publié au Seuil, profitant de son influence non négligeable. Même si, paradoxalement, il dit dans une même phrase avoir « été content de (me) connaître » et souhaiter « garder le contact avec (moi) ». D’où le brouillon de mon courrier, désespérément touchant et si maladroit. Mais sincère (annexe 7, dont la mise en forme définitve a été envoyée à M. Bonnefis à mon retour de vacances début septembre 71). Tout en me raccrochant à Barthes (annexe 8), ne soyons point hypocrite, par le biais de l’envoi de mon Mémoire, même si ma démarche était totalement honnêtement légitime.
Sa carte postale de Bayonne me rassura (annexe 9).
La suite de nos relations en pointillé relève avec le recul du comique troupier ! En date du 17 décembre 71 (annexes 10 et 10 bis), sa lettre est repassée à un laconique « mon cher Fosse », bien loin du « cher ami » de septembre, tout en renouvelant toujours paradoxalement son désir d’une « collaboration en souffrance » …
Dès janvier 72, son petit mot semble montrer une relation de son côté de plus en plus socialo-universitaire, même s’il entérine son champ lexical habituel très charnel (annexes 11 et 11 bis). Du mien, étant inscrit à Lille en Licence de Psychologie option Sociale tout en suivant les cours du 3ème cycle de Gestion (le soir, puisque j’étais encore Surveillant d’Externat) que j’ai bouclé en un an au lieu des deux autorisés vu mon cursus littéraire, il me restait peu de temps pour me projeter concrètement dans une Thèse de 3ème cycle. Mais malgré cela, le brouillon de lettre retrouvé montre que je ne perdais pas de vue ce projet, étant très désireux d’écrire quelque chose sur Baudelaire qui m’avait influencé et m’influençait dans mon univers personnel de poète (!).
Que lui ai-je écrit pour qu’il m’envoie son mot du 12 février (annexe 12) ? Je ne sais plus, mais l’homme semble de plus en plus fatigué et tiraillé entre des contraintes professionnelles extrêmes parmi lesquelles la lecture de mon Mémoire semble anecdotique puisque reportée une fois de plus, bien que ses mots soient très forts (« votre travail … fait partie de moi-même »).
De février 72 à son petit mot du 18 juin, où il me confirme son accord en tant que Directeur de ma Thèse, marque d’amitié particulière, au-delà de l’aspect strictement universitaire, dans la mesure où il semble saturé en tous points, débordé qu’il est par ses multiples obligations, qu’il le dit et le répète, mais qui ne l’empêche pas de faire « bien sûr exception pour (moi) » (annexe 13), refusant toute autre demande d’étudiant (ce point est-il vérifiable eu égard à ce qu’il prétend (« je ne prendrai pas de nouvelles thèses l’année prochaine »)?), je n’ai retrouvé qu’un brouillon de lettre de ma part (annexe 14) où je lui suggère, avec l’accord de M. Bonnefis, un titre de Thèse, qu’il accepte donc en juin 72. Ainsi qu’une coupure du journal La Voix du Nord lors de sa venue à Lille dans le cadre d’un colloque sur la sémantique dans lequel son intervention était le point d’orgue (annexe 15).
Suite à son passage, je suis allé le voir avec son Sade, Fourier, Loyola qu’il avait édité fin 71 et qu’il m’a gentiment dédicacé, en remerciement de mon travail sur ses œuvres de 53 à 71 (annexe 16). Sans plus. Je n’ai jamais su s’il avait finalement lu en vacances d’été 72 mon Mémoire. J’ose croire que oui, même s’il semble que personne n’en ait retrouvé trace depuis chez lui à Paris ou Urt, dans la mesure où, sans vouloir me donner une importance ou une sorte d’influence que je n’ai évidemment pas, j’ai cru décoder, au détour d’un thème ou d’un paragraphe, dans certains de ses écrits ultérieurs, une (lointaine?) réminiscence de mon écrit. Au moins, comme un écho. … thématique. Ou alors, c’est moi qui n’ai fait que traverser ses images de prédilection qui ont jalonné toute son œuvre, avant et après notre rencontre.
Et pourtant, malgré ce curieux silence, cette absence de commentaire de sa part, j’ai bien suivi son Séminaire du jeudi (retour à l’annexe 1, histoire de boucler la boucle) de novembre 72 à 73, où j’étais le seul « provincial » (Barthes -1972) parmi les 15 étudiants parisiens collés à sa divine parole, point non neutre puisque lui-même me disait que nous avions cet « élément » commun qui me privilégiait par rapport aux autres disciples. Il n’y avait pas que cela : je ne faisais pas partie de leur mentalité et/ou de leur état d’esprit qui leur faisait déployer bien ostensiblement devant eux sur la table commune autour de laquelle nous étions assis religieusement, un exemplaire du Monde Littéraire qui paraissait le matin, je crois, genre de comportement qui faisait plus que l’indisposer, symbole d’un parisianisme « superficiel » (je crois que c’était son mot) d’ « écrivants » … Ce « commerce intellectuel qui se donne toujours des airs naturels » (RB -1972 – cf. annexe 8).
Personnellement, de 72 à 73, outre mon inscription au Doctorat de 3ème cycle (annexe 17 et 17 bis), j’enseignais en Collège et terminais mon auto-analyse sous l’égide de Maître Parquet, le ponte lillois de l’époque en matière de psychanalyse, qui m’a adoubé aux environs de Pâques, à la même époque que la fin du Séminaire de Barthes, en tous cas. Mais ceci est une autre histoire. De fait, j’étais de plus en plus orienté vers d’autres sphères, d’autant que je venais à la rentrée 73 d’être recruté comme intervenant en Faculté, en attendant mieux dès 74, ce qui est encore une autre histoire, sans intérêt ici (cf annexe 18). Quant à la poursuite de ma Thèse, après avoir tenté d’y travailler épisodiquement étant donné mes activités, jusqu’en 74 davantage qu’en 75 (annexe 19), elle sera restée lettre morte et j’en demande pardon et à Baudelaire et à Barthes !
Je voudrais, dans cette dernière note, remercier mon éternel Maître ès Sémiologie, Monsieur Roland Barthes, qui m’a accompagné toute ma vie personnelle et professionnelle et à qui je dois le grand basculement de mon parcours universitaire en ce sens qu’ayant eu la chance à l’écrit du Capes en 71 d’avoir un sujet tiré d’une de ses œuvres (plus aucun souvenir et apparemment il apparaît peu évident de retrouver trace du sujet exact proposé, malgré les efforts plus que généreux de M. Coste), j’ai eu le culot – c’est le mot – de glisser dans ma dissertation à la rigueur et l’équilibre formels impeccables – merci à ma vieille mère, Major de Normale – que je connaissais personnellement l’auteur et implicitement au moins aussi bien le sujet que mon correcteur. Et soit ledit correcteur me traitait de prétentieux et me gratifiait d’un royal 2 éliminatoire, soit il reconnaissait intelligemment et humblement la chose et m’attribuait le … seul 16/20 de cette année-là (il y eut quelques 15) qui, certes, m’ouvrait grâce au coefficient toutes grandes les portes de l’oral, mais qui, surtout, m’a donné l’occasion d’avoir l’insigne honneur d’être interrogé par le Président du Jury (je vois encore et ô combien nettement, ma copie sur sa table, quand je suis allé signer ma passation) qui a passé dix minutes de son temps à me démontrer que la Littérature, la vraie, la grande, n’était pas celle d’un Roland Barthes mais celle « d’avant » et qui, lui, nonobstant tout ce que j’ai pu dire sur Verlaine, le sujet de mon oral, m’a royalement accordé un 6/90 (non divisible) qui m’a fait échouer – ô bonheur – à quelques places près. Merci en conséquence à Barthes de m’avoir libéré de ce monde pour lequel je n’étais pas fait. Et paix à son âme.
ANNEXES
Annexe 1

Annexe 2, 2bis

Annexe 3

Annexe 4, 4bis



Annexe 5



Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10, 10bis


Annexe 11, 11bis

Annexe 12


Annexe 13


Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16


Annexe 17, 17bis


Annexe 18

Annexe 19