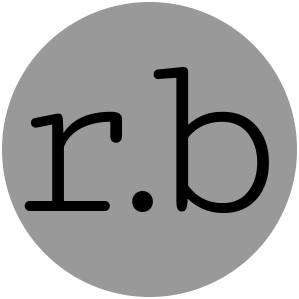Bien avant toute une génération de penseurs iconoclastes du XXe siècle, comme Guy Debord,...
Revue Roland Barthes, n°6 / Rodrigo Fontanari & Magali Nachtergael (dir.) /Juillet 2023
Ce dossier, tombé en plein Covid, a été considérablement ralenti et nous souhaitons remercier les contributeur·ices ainsi que les éditeurs de la revue pour leur aimable patience. Les restrictions d’accès aux collections de la Bibliothèque nationale de France ont de surcroît empêché une contribution prévue en 2019, qui portait sur les sociabilités photographiques de Barthes dans les années 1970.Si le dossier ne couvre pas tous les aspects des relations entre Barthes et les photographes, il s’intéresse aussi au rôle esthétique, politique des photographes dans les écrits de Barthes sur la photographie à travers la contribution d’Andy Stafford sur les photographies qu’a fait Roger Pic de la pièce de Bertolt Brecht, Mère courage. L’article de Kathrin Yacavone couvre quant à lui les représentations de la figure de l´auteur et sa construction, à partir d’un corpus d’images publiques, prises en particulier par la photographe Sophie Bassouls et documentées par une correspondance avec Barthes. Étant donné les élections de Barthes en matière de photographie, Rodrigo Fontanari revient sur le cas Daniel Boudinet, emblématique des prises de positions esthétiques barthésiennes. Il prend avec ce photographe des natures bucoliques et du minimalisme visuel, le contre-pied de tendances dominantes, telles que la photographie de rue ou le photojournalisme, dont La Chambre claire enregistre l’existence tout en déplaçant les points de vue autour de deux notions, le « studium » et le « punctum », et laissant une plus grande place à la subjectivité dans la relation à l’image. Car la relation de Barthes n’est pas celle d’un photographe amateur avec des objets dont il saisirait l’image. Délaissant « l’operator », au profit du « spectator », il est, comme le démontre Anne-Cécile Guilbard, un manipulateur de clichés, un metteur en scène, qui pratique la photographie sans photographier, et par conséquent, « sans photographe ». C’est bien toute la difficulté de cerner la relation de Barthes avec les photographes qui passe surtout et avant tout par sa propre subjectivité et construit une théorie de la photographie sans les opérateurs. Prenant le tour d’un dialogue inachevé, Jean-François Dreuilhe analyse la brève correspondance entre Lucien Clergue et Barthes, autour du jury de thèse et de la publication de Langage des sables. Pierre Taminiaux, revenant sur La Chambre claire « quarante ans après » sous une forme essayistique, fait le récit de l’apport de Barthes à la réflexion sur la photographie en France. Enfin, Leda Tenorio da Motta analyse la place des photographes dans la dernière philosophère visuelle barthésienne, et soulève l’hypothèse d’une théorie de l’image liée au silence, et radicalement inscrite dans un « degré zéro » du style photographique.

De la pose à la posture : Roland Barthes devant l’objectif
« Si je refuse l’Image, je produis l’image de celui qui refuse les Images… »[1]. Ainsi Roland...
Daniel Boudinet, le photographe de la nuance
« Mais du reflet qu’elle [photographie] n’est, elle naît », Denis Roche Nulle photographie,...
Barthes – Clergue, l’échange d’un instant.
Frustré de ne pouvoir intégrer un conservatoire de musique, Lucien Clergue délaissa son violon et...
Pic, Théâtre, Légende : aux origines du photo-textualisme barthésien
« Ce que j’aime au fond, c’est le rapport de l’image et de l’écriture, qui est un rapport...
Roland Barthes et la Photo-sans-le-photographe
Roland Barthes en était tout à fait conscient à la publication de La Chambre claire : « ce livre...
Écouter le silence, voir la mort. Les dernières photographies de Roland Barthes.
Introduction Peu de jours avant sa disparition, Roland Barthes avait confié à Denis Roche qu’il...
La Chambre claire, du XXe au XXIe siècle : un autre temps de l’image.
Plus de quatre décennies ont passé depuis la parution de La Chambre claire, l'essai majeur de...