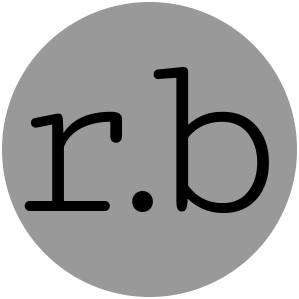Le souci de l’avenir qui se fait jour chez Barthes a commencé d’être étudié et documenté, en particulier le désir utopique ou le grand projet romanesque Vita nova qui a occupé Barthes dans les dernières années de sa vie. Sans délaisser ces motifs, l’ambition de ce numéro est de rendre son ampleur à ce souci, afin d’en restituer le dynamisme et la pluralité, d’en dégager les lignes de forces et les variations. Si l’œuvre de Barthes apparaît à bien des égards comme mangée d’avenir, il reste à observer comment cette aimantation particulière à l’égard du futur évolue dans le temps, et comment celle-ci se décline suivant des échelles, des portées et des régimes variés.
Revue Roland Barthes, n°4 / Adrien Chassain & Laurent Demanze (dir.) / Juillet 2018
Nous souhaiterions consacrer ce numéro à l’exploration d’un « souci de l’avenir » à l’œuvre chez l’essayiste. S’il a souvent fait état d’une gêne insistante à l’égard de la rétrospection, Barthes a inversement envisagé l’avenir sous le signe favorable du nouveau, de l’aventure, de la possibilité offerte d’une « mutation » personnelle et d’une émancipation collective. Marqueur moderne par excellence, allégorisée par la figure de Moïse marchant au-devant de la Terre promise, cette « part résolument protensive » de l’écriture de Barthes s’observe de bien des manières : elle apparaît dans l’intérêt jamais démenti de l’auteur pour la pensée utopique, dans l’imaginaire pionnier propre à l’aventure sémiologique au tournant des années 1960, dans le geste répété de placer un fantasme au départ d’un essai ou d’un cours, comme encore dans le réinvestissement du genre délibératif de l’ancienne rhétorique à la fin des années 1970. En témoigne, enfin, la multiplication des projets de livres – quand ce n’est pas de sciences entières –, égrainés au fil des ans dans les ouvrages, articles, entretiens, cours et séminaires… autant de « prospectus » que Barthes a recensés et commentés dans son autoportrait de 1975.
Ce souci de l’avenir a commencé d’être étudié et documenté, en particulier le désir utopique ou le grand projet romanesque Vita nova qui a occupé Barthes dans les dernières années de sa vie. Sans délaisser ces motifs, l’ambition de ce numéro est de rendre son ampleur à ce souci, afin d’en restituer le dynamisme et la pluralité, d’en dégager les lignes de forces et les variations. Si l’œuvre de Barthes apparaît à bien des égards comme mangée d’avenir, il reste à observer comment cette aimantation particulière à l’égard du futur évolue dans le temps, et comment celle-ci se décline suivant des échelles, des portées et des régimes variés.

Barthes cybernéticien ?
La cybernétique se caractérise par une transdisciplinarité et un usage contrôlé du procédé de l’analogie homme/ machine. Elle n’est pas une approche relativement unifiée que Barthes adopte, emprunte, braconne ou bricole puisqu’elle se donne d’emblée comme une configuration plus ou moins mouvante selon l’auteur qui s’en réclame.
Barthes à l’ère numérique
Bien que souvent présenté comme un antimoderne, selon la formule contestée d’Antoine Compagnon, Roland Barthes est, volens nolens, éminemment présent à l’ère numérique : sa description du monde comme un espace plat de signes global permet de comprendre la conversion du monde en data
La responsabilité de Roland Barthes
La responsabilité est l’un des gestes prospectifs majeurs, et son emploi chez Barthes s’avère double et problématique. Elle est tantôt fortement affirmée et tantôt refusée avec une nonchalance provoquante. C’est que la notion de responsabilité a pour Barthes deux valences différentes : une responsabilité sélective remontant à l’engagement sartrien et impliquant un choix à faire, et une responsabilité intégrale qui consiste à savoir ne pas choisir. La double idée de responsabilité se laisse suivre à travers quelques grandes oppositions conceptuelles de Barthes : dénotation/connotation, sujet/prédicat, langue/écriture, science de la littérature / critique, écrivains/écrivants, corps/image, et aussi science/littérature.
Roland Barthes : moderne, antimoderne, postmoderne, après-moderne ?
La pensée de Roland Barthes était tellement ondoyante, comme un tissu diapré virevoltant autour d’une danseuse andalouse, ou comme les camaïeux qu’il a évoqués dans son cours sur le Neutre, qu’il est loisible de tenir à son sujet des propos tout à fait contradictoires sans pour autant se fourvoyer. Soit deux lecteurs s’opposant frontalement quant à leur interprétation de son œuvre : il se peut qu’ils aient tous deux raison. Aussi, comme le note Claudia Amigo Pino : « Il est possible de classer l’œuvre de Barthes en mille parties : on peut parler du Barthes sémiologue, du Barthes hédoniste, du Barthes critique… Mais il est également possible de classer ses lecteurs […]. »
Penser la théorie au futur (Barthes, Genette, Todorov)
C’est souvent avec inquiétude ou circonspection, aujourd’hui, que l’on évoque l’actualité, et a fortiori l’avenir de la théorie littéraire. Depuis le reflux du structuralisme vers le mitan des années 1970, l’heure du bilan n’a cessé de sonner. Antoine Compagnon, Tzvetan Todorov et d’autres ont ainsi multiplié ces dernières années les témoignages et les synthèses, se retournant sur ce présumé « âge d’or » de la théorie littéraire, pour en dresser l’inventaire et en juger la postérité.
« Nihil nisi propositum » : Roland Barthes et la poétique de l’œuvre à venir, entre projet et commande
Barthes s’est lui aussi livré à l’exercice de l’autobibliographie prospective et mérite sans conteste d’être tenu pour un écrivain à projet. Par là, je veux dire que l’essayiste ne s’est pas contenté d’avoir des projets, chose banale en vérité, mais qu’il a fait de cette activité protensive un objet d’annonce, de délibération et de théorisation à part entière.
L’œuvre comme virtualité
Le travail de Roland Barthes est habité par le désir d’écrire, et par une relation fantasmatique à la virtualité de l’œuvre. « Un fantasme (ce que du moins j’appelle ainsi) – écrit Barthes, dans les notes du séminaire Comment vivre ensemble– un retour de désirs, d’images, qui rôdent, se cherchent en vous, parfois toute une vie, et souvent ne se cristallisent qu’à travers un mot. » De ce point de vue, il est intéressant de rapprocher deux séminaires, donnés à quelques années de distance, l’un à l’École Pratique des Hautes Etudes (Le Lexique de l’auteur), l’autre au Collège de France(La Préparation du roman), pour revoir ce rapport particulier à la virtualité d’écrire.
« Peut-être tardif », la patience de Barthes
Le motif du retard n’est pas sans importance chez Barthes ; les « avenirs de Barthes », il nous semble, ont souvent tardé. Des débuts jusqu’aux derniers cours et ouvrages, si l’écriture de Barthes manifeste une force de rupture, des accélérations de pensée, elle compose avec un suspens existentiel, une traversée de l’attente ; en cela, elle aurait partie liée avec une certaine modalité de la patience. C’est cette patience en sa singularité qui fait ici l’objet de notre questionnement. Quel statut est-il possible de lui accorder ? Quel sens, tant existentiel que scriptural, lui donner ?
« Aveniro-manie » ou le temps des images de l’autre. Cinéma, photogrammes, images sonores dans l’œuvre du dernier Roland Barthes (Journal de deuil et La Préparation du roman)
L’hypothèse qui sera défendue ici est que c’est en passant par une réflexion sur les images – et particulièrement les images cinématographiques, dans leur rapport à la photographie – que Barthes arrive à investir de manière originale le paradoxe d’une écriture de vie qui, à même le deuil, trouve un second souffle pour fabuler l’avenir : ce « Roman-Fragments » (PR, p. 48), dont le devenir serait fondé sur l’expérience achoppée du présent. Par sa sensibilité envers les images, Barthes saura renouveler sa vision de l’écriture. Celle-ci s’en trouvera projetée dans un vaste récit aux temporalités multiples dont le sujet premier, justement, n’est nul autre que le Temps en personne.
À quoi donc la vita nova de Barthes peut-elle nous convertir ?
Si le choix fait par Barthes de donner pour titre Vita Nova à son ultime projet d’écriture justifie à lui seul de se concentrer sur ce thème, la publication posthume des huit esquisses éponymes, comme celles de la conférence « “Longtemps je me suis couché de bonne heure…” », du cours La Préparation du Roman et des journaux intimes Soirées de Paris et Journal de Deuil, témoignent de ce qu’il existe à présent un corpus considérable d’écrits – sans compter « Délibération » et La Chambre claire publiés du vivant de Barthes – à travers lequel on peut explorer la manière dont Barthes exploita (ou avait l’intention d’exploiter) ce topos des plus littéraires.
La peur
La démarche biographique est une démarche de compréhension : saisie intellectuelle et totalité, connaissance compréhensive (selon la définition du TLF, « Qualité, attitude d’une personne compréhensive, capable de saisir la nature profonde d’autrui dans une communion affective, spirituelle allant parfois jusqu’à une très indulgente complicité »). Certains points résistent pourtant à toutes ces formes de compréhension, ce qui est le cas avec Barthes de la peur.